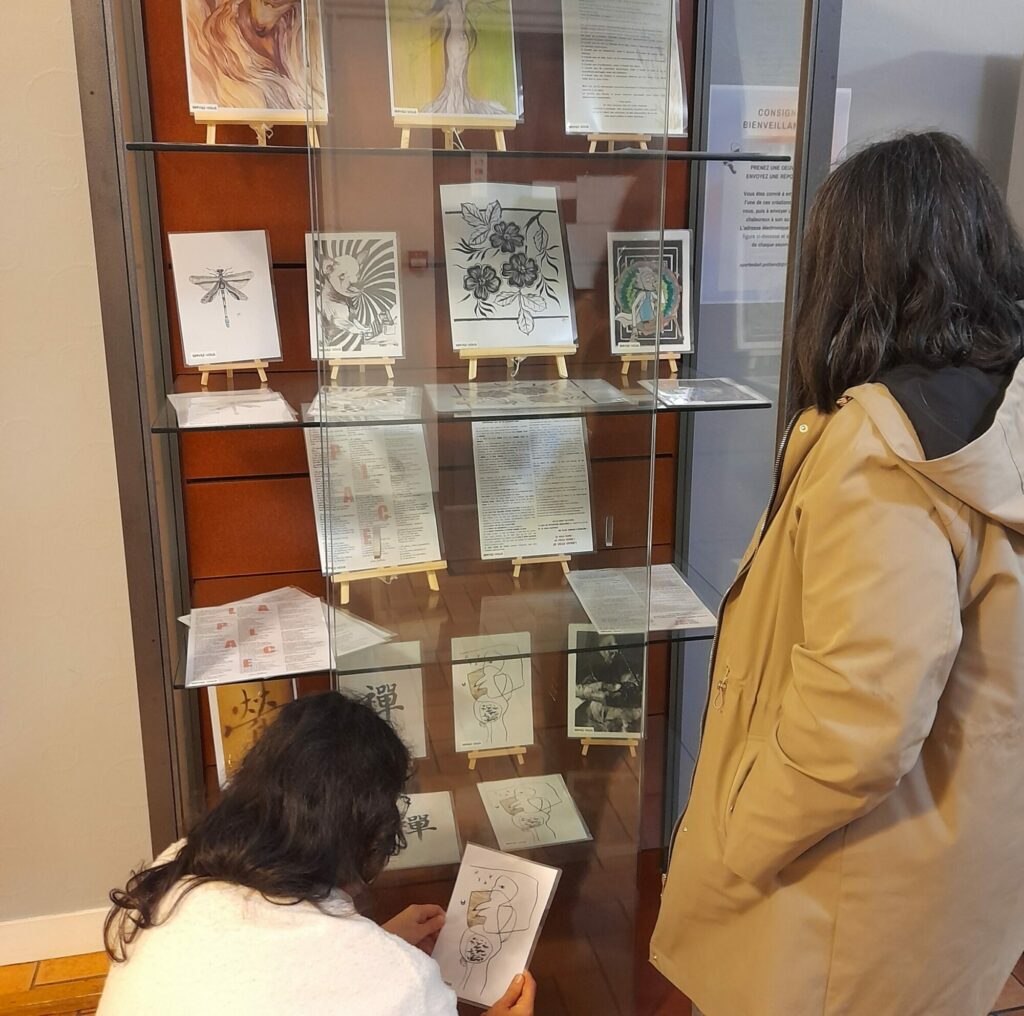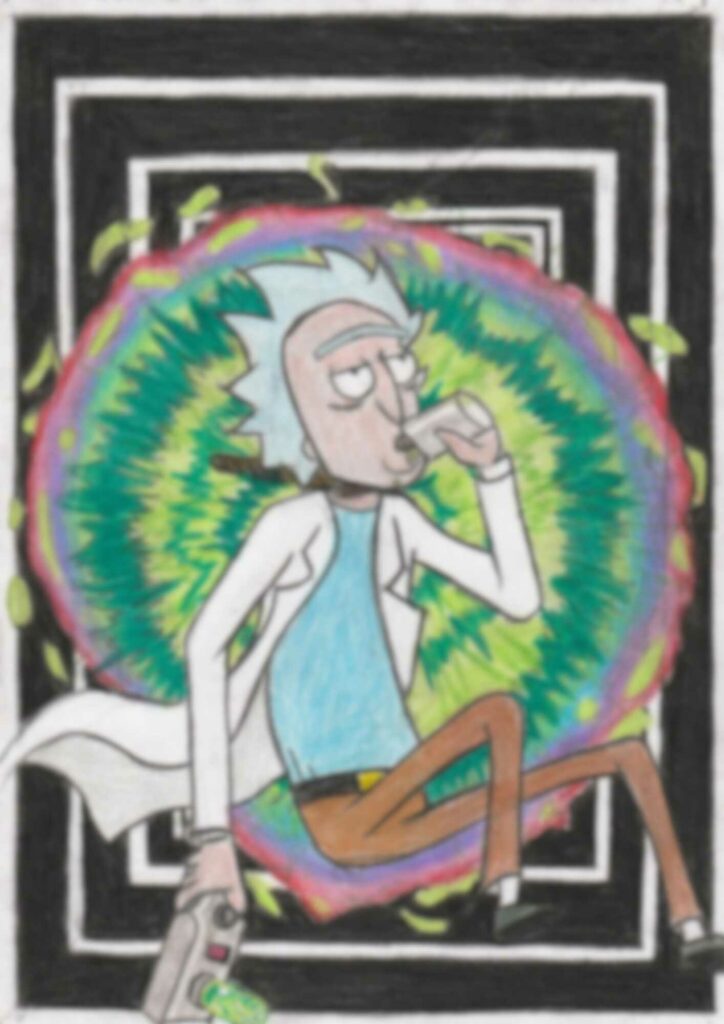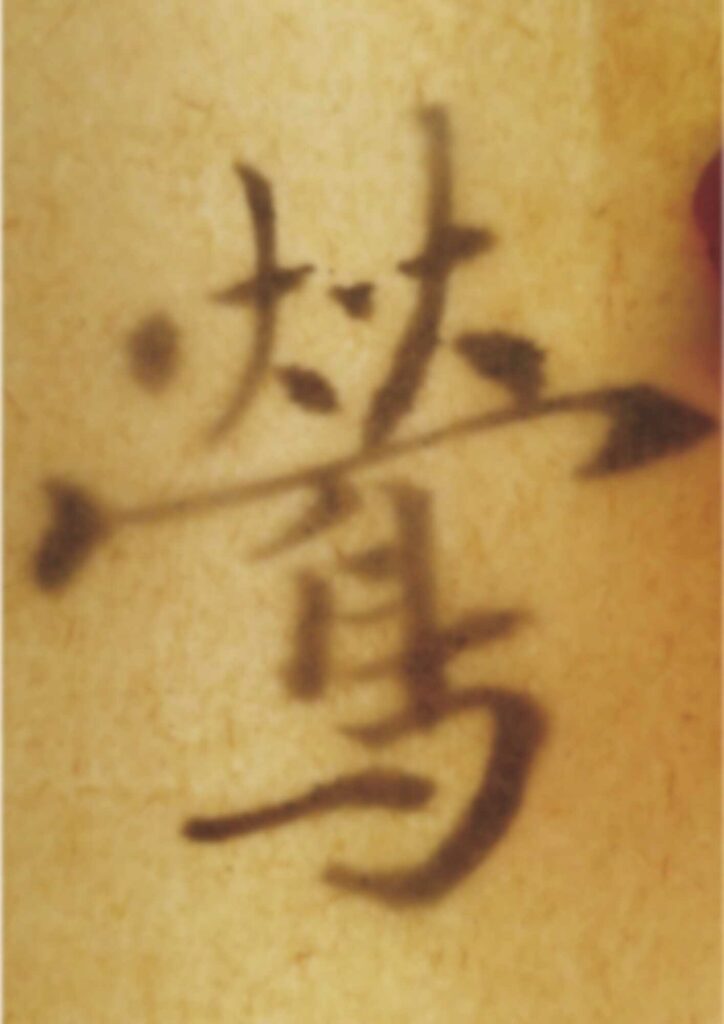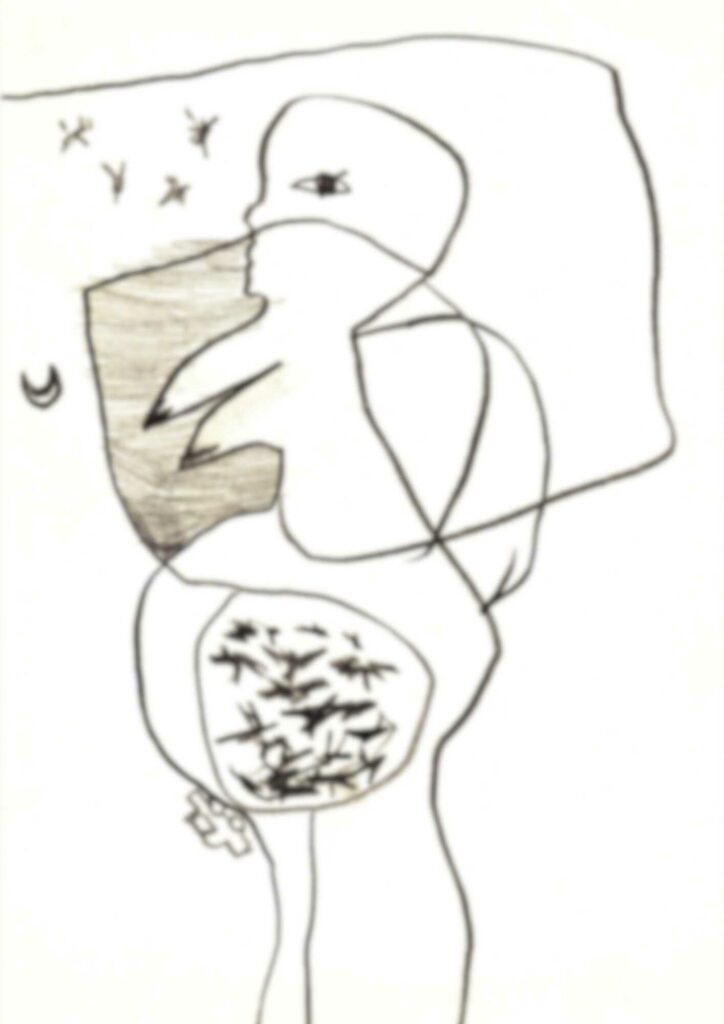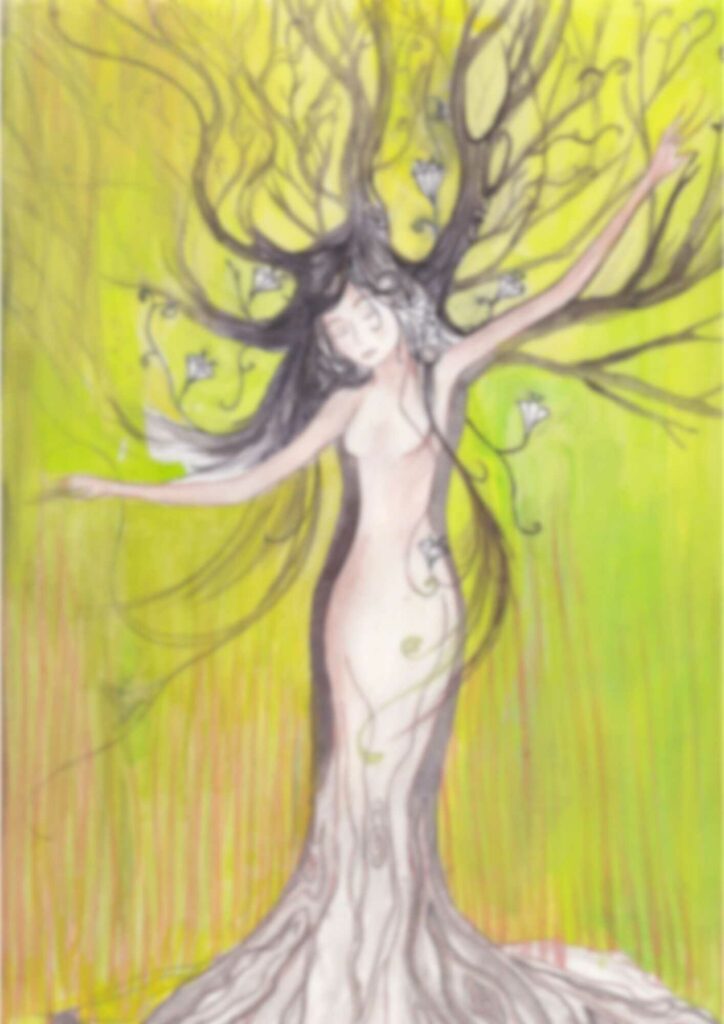Mois : juillet 2025
Dessiner pour mieux rêver : les premiers croquis de la Zone de Partage
Pour mieux expliquer mon projet Zone de Partage, j’ai pris mes crayons et réalisé quelques dessins techniques et illustratifs. 📐🖍️
Continuer la lectureUne Histoire de Partage (8) : les temples zens
🍵 Et si l’on pouvait, sans rien demander, recevoir un bol de riz et une tasse de thé ?
Continuer la lectureUne Histoire de Partage (7) : les repas gratuits sikhs
🥣 Et si, chaque jour, des milliers de repas gratuits étaient servis sans poser de questions ?
Continuer la lectureUne Histoire de Partage (6) : les dîners gratuits des soufis
🍲 Et si offrir un repas à tous avait été, pendant des siècles, un acte spirituel ?
Continuer la lectureZone de Partage : une belle dynamique se met en place !
Le projet Zone de Partage entre dans une nouvelle phase d’accélération, avec de nombreuses avancées enthousiasmantes ces derniers jours. Voici
Continuer la lecture