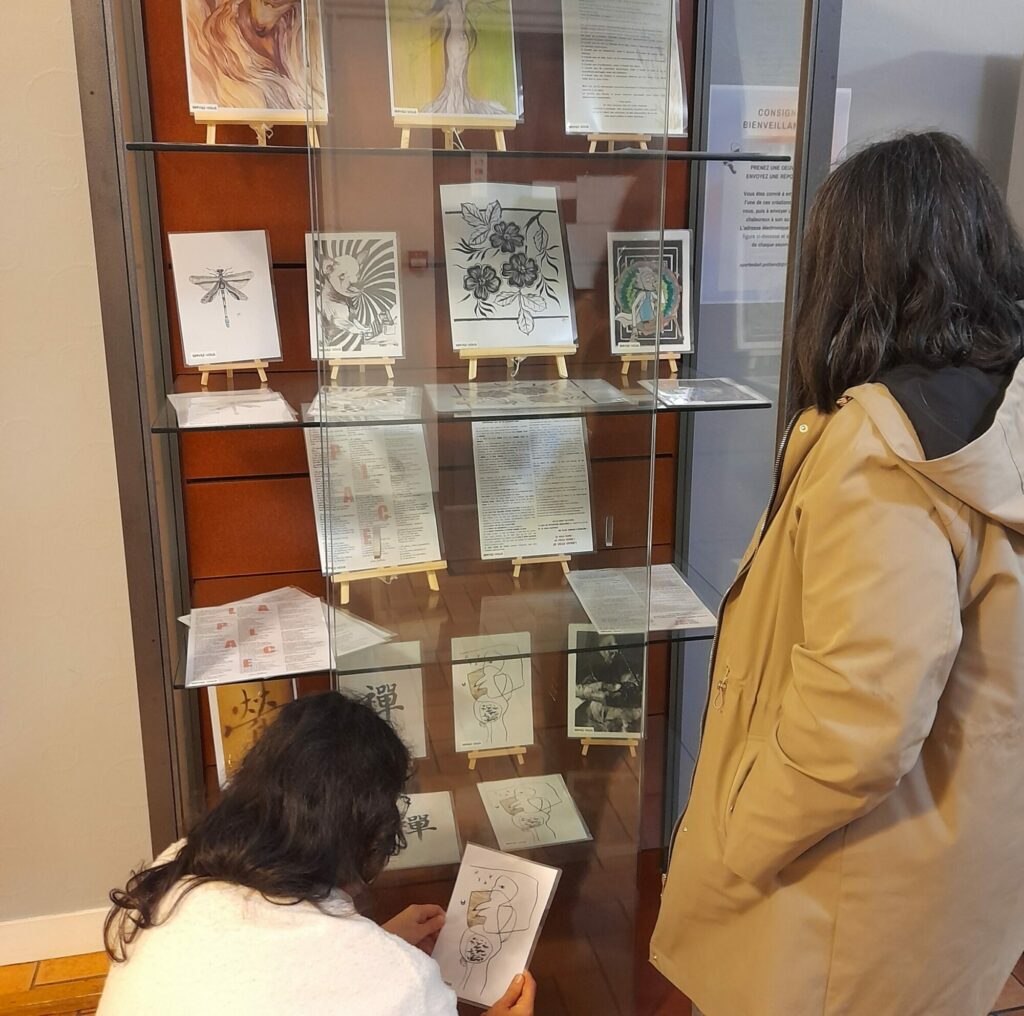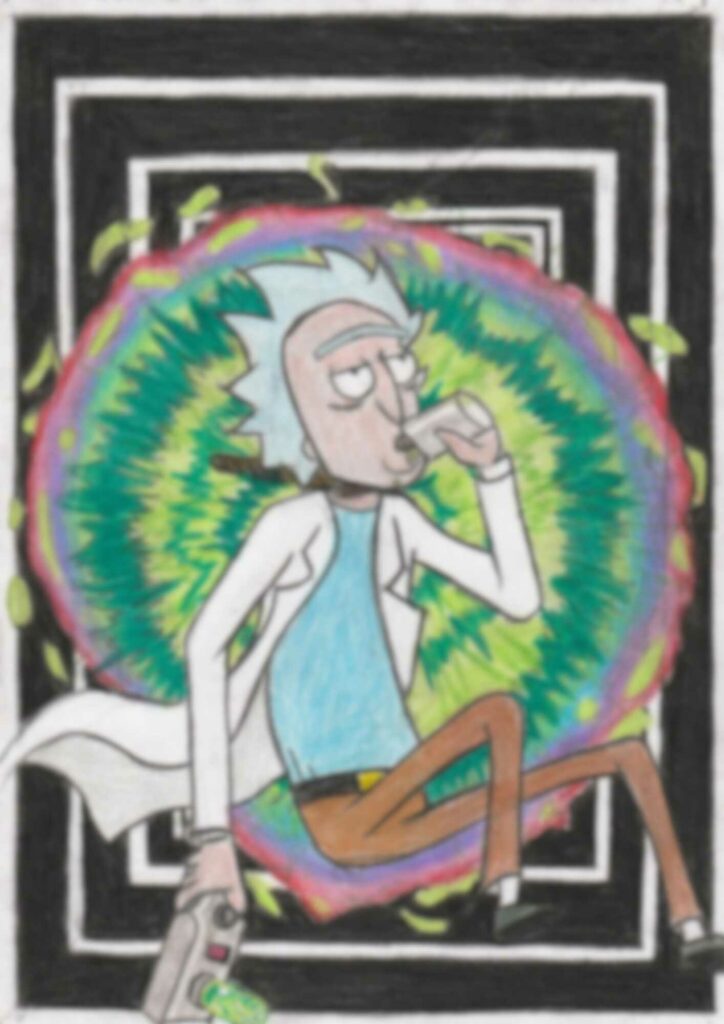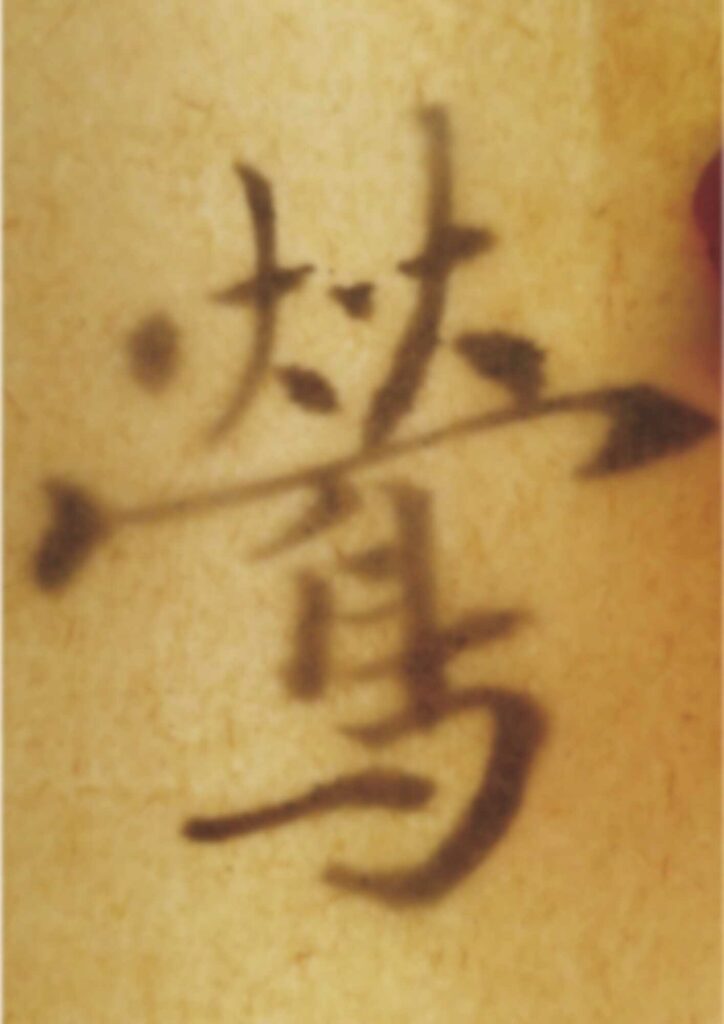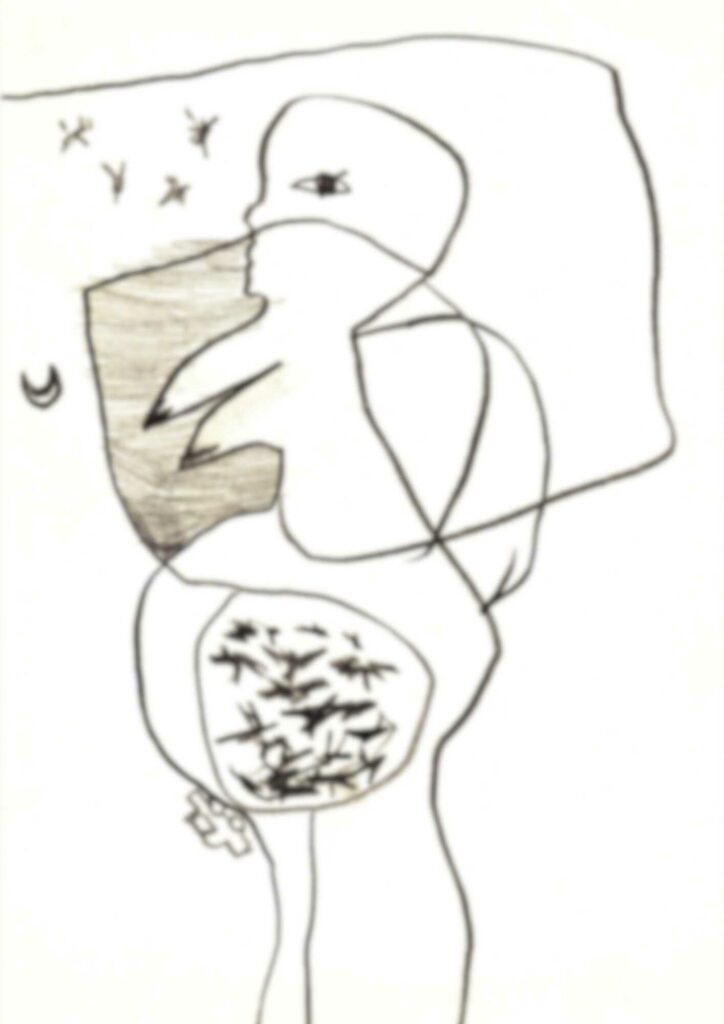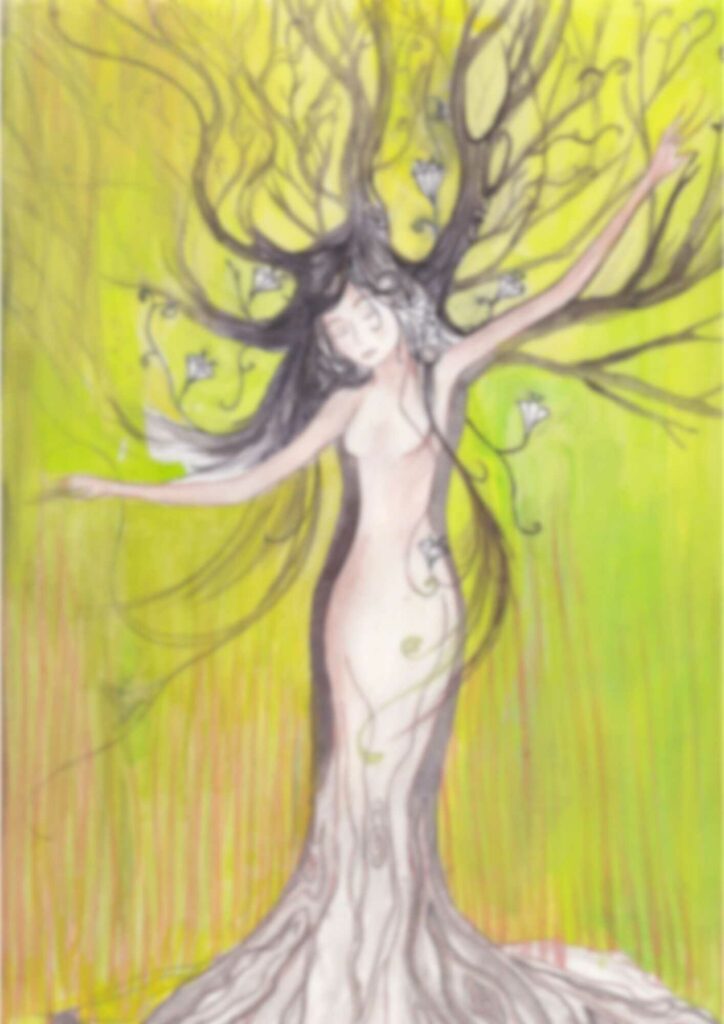Une Histoire de Partage (15) : l’instruction gratuite en France (loi Ferry 1881)

📘 Et si un jour, on avait décidé que le savoir ne devait plus dépendre de l’argent des parents ?
En 1881, la France adopte une loi qui change profondément son avenir : l’instruction primaire devient gratuite pour tous les enfants. Initiée par le ministre Jules Ferry, cette mesure marque un tournant majeur dans l’histoire de l’éducation : elle affirme pour la première fois que le savoir est un droit commun, et non un privilège réservé à quelques-uns.
🏫 Une réforme pensée pour réduire les inégalités
Jusqu’alors, aller à l’école impliquait souvent de payer : pour l’inscription, les fournitures, parfois même pour l’enseignement. Cela excluait une grande partie des enfants, en particulier dans les familles paysannes et ouvrières.
Avec la loi du 16 juin 1881, l’enseignement primaire public devient gratuit (suppression des droits de scolarité), même si les familles doivent encore souvent payer fournitures et manuels.
L’année suivante (28 mars 1882), l’école primaire publique devient obligatoire de 6 à 13 ans et l’enseignement est laïc (religion remplacée par l’instruction morale et civique). La laïcisation du personnel sera achevée par la loi Goblet de 1886.
Le but de cette réforme est double :
– former des citoyens éclairés dans une République jeune et encore fragile,
– lutter contre les inégalités sociales, en offrant les mêmes bases à tous les enfants, qu’ils soient riches ou pauvres, urbains ou ruraux.
📖 Une mesure ambitieuse, qui transforme la société
La mise en œuvre de la gratuité ne s’est pas faite sans résistance. Elle a nécessité :
– la création massive d’écoles, y compris dans les villages isolés (cette expansion était déjà amorcée au XIXe siècle)
– la formation d’instituteurs et d’institutrices, appelés plus tard « hussards noirs de la République »,
– des programmes communs, centrés sur la lecture, l’écriture, le calcul, l’histoire, la morale civique.
Peu à peu, la réforme porte ses fruits :
– les taux d’alphabétisation augmentent rapidement,
– les enfants de familles modestes accèdent à des parcours éducatifs nouveaux,
– l’école devient un lieu central dans la vie des communes et des familles.
🌍 Une influence au-delà de la France
Le principe d’instruction gratuite, obligatoire et laïque a inspiré d’autres pays, notamment en Europe et en Amérique latine. Il a contribué à faire de l’éducation un pilier des politiques publiques modernes, fondé sur l’idée que l’apprentissage ne doit pas dépendre du revenu des parents.
Ce modèle est à la base de nombreuses Constitutions, et alimente encore aujourd’hui les débats sur la gratuité de l’université, des manuels scolaires, ou des cantines.
💬 Une idée à faire vivre chaque jour
La loi Ferry nous rappelle une vérité simple :
l’accès au savoir est l’une des clés les plus puissantes pour lutter contre les inégalités.
Et que pour qu’il soit réel, il doit être garanti, protégé et transmis à toutes et à tous, dès le plus jeune âge.
Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par :
– aider un enfant en difficulté, sans jugement,
– partager une ressource éducative, même modeste,
– défendre l’école publique comme un lieu commun et non un service réservé,
– refuser l’idée que seuls ceux qui peuvent payer auraient droit à un bon enseignement.
Rendre le savoir accessible, ce n’est pas juste offrir des cours gratuits. C’est reconnaître que chaque esprit mérite de se développer, sans condition.
Et c’est peut-être cela, aujourd’hui encore, le sens profond de la loi de 1881 :
📚 rendre la connaissance disponible à tous, c’est rendre la société plus juste pour chacun.