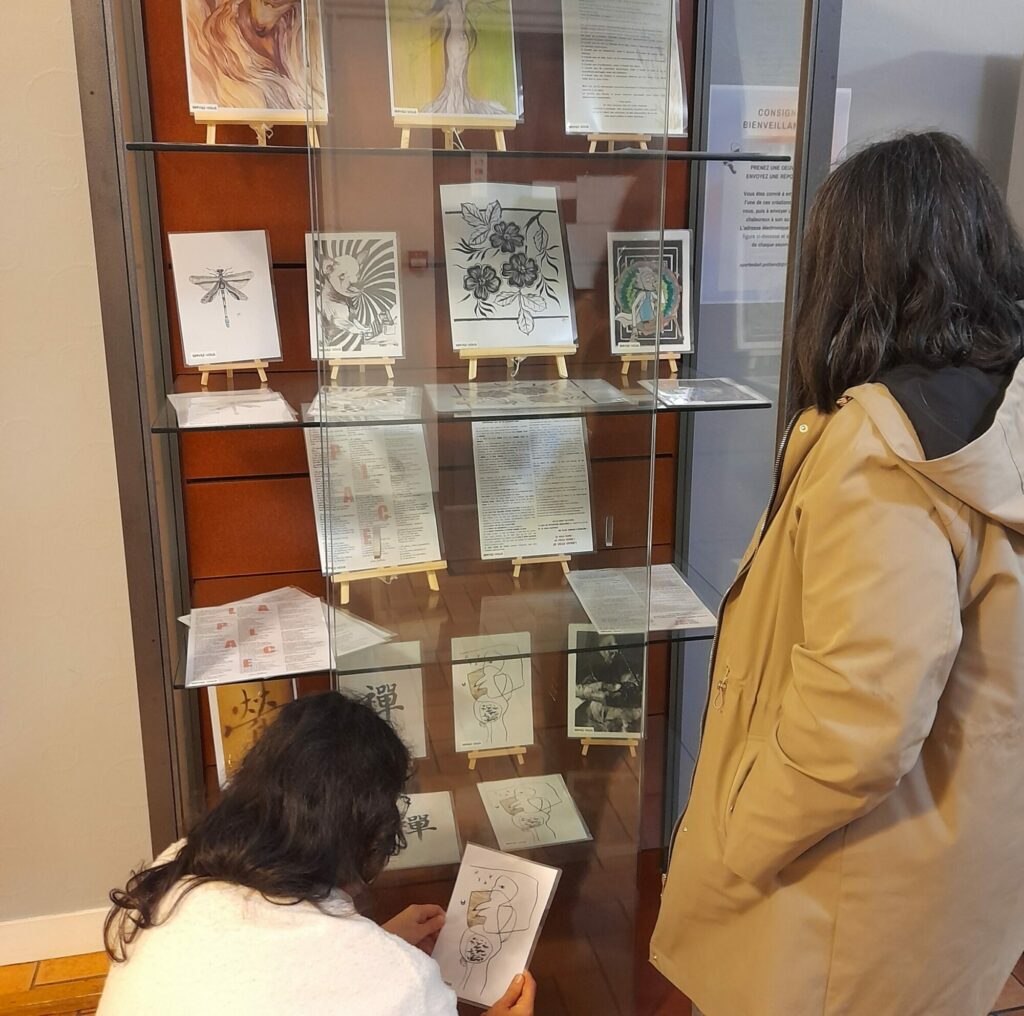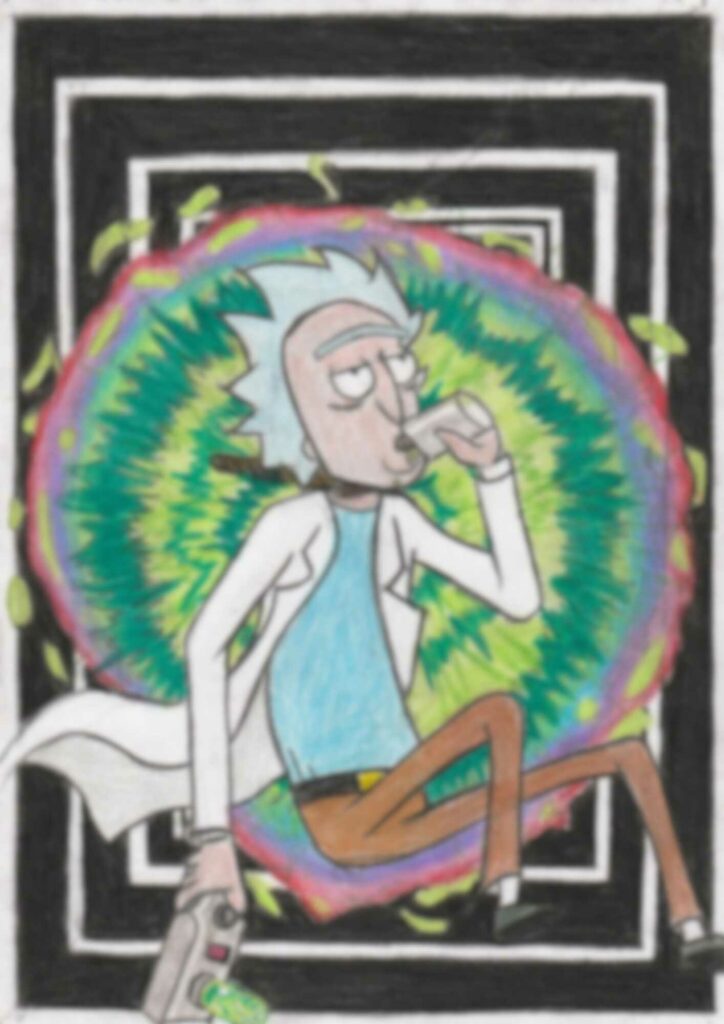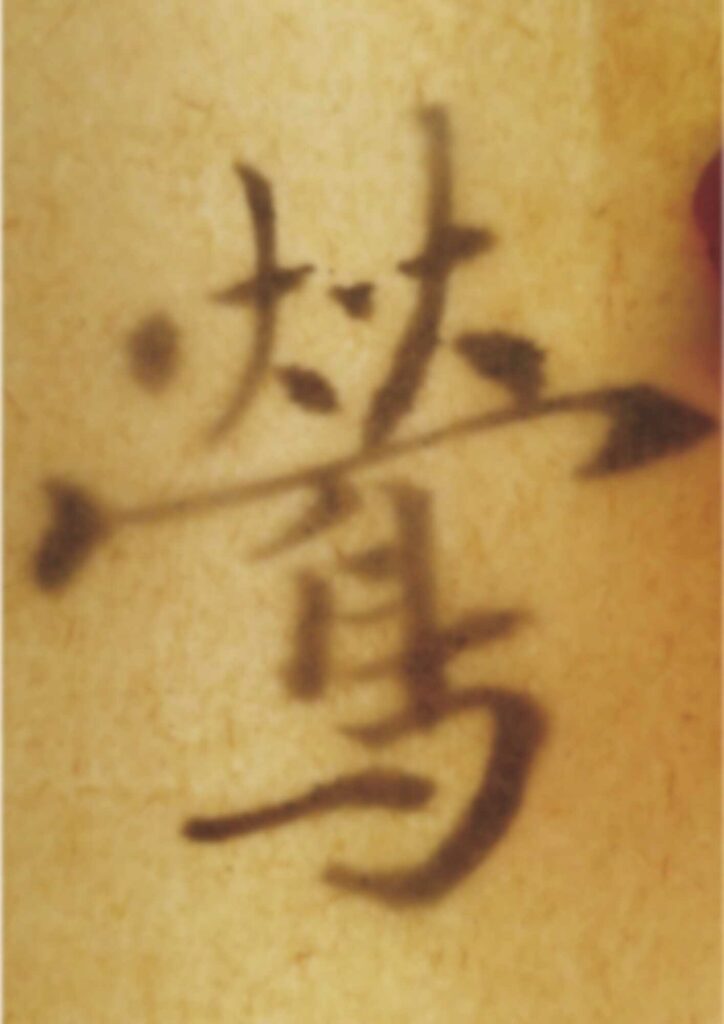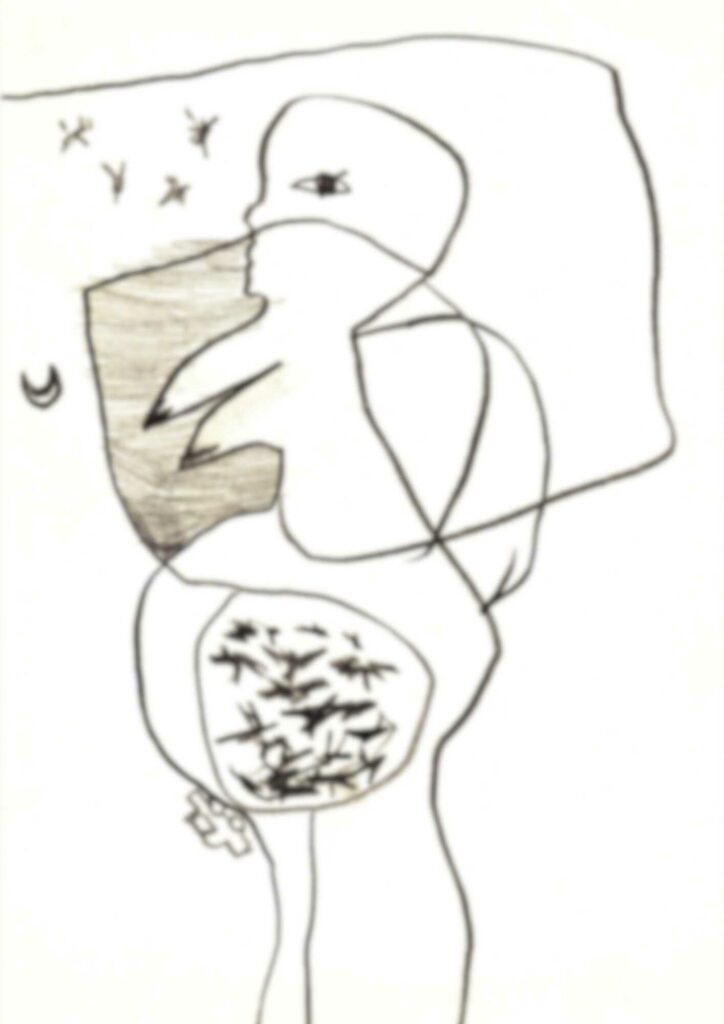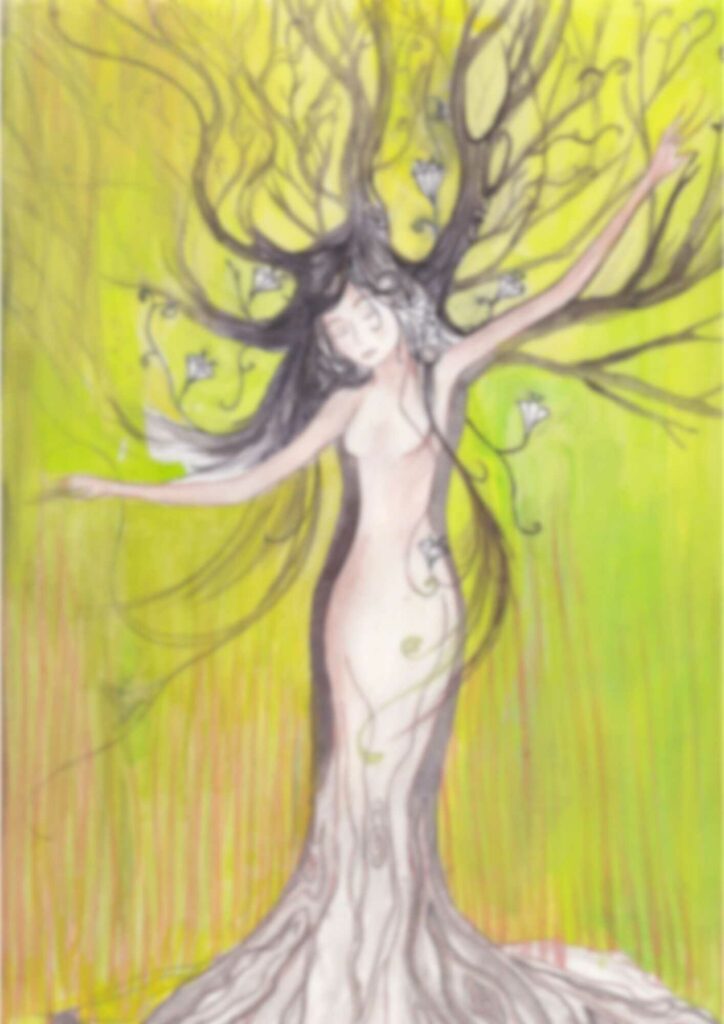Histoire de Partage (18) : le mouvement des “Gratiferias”
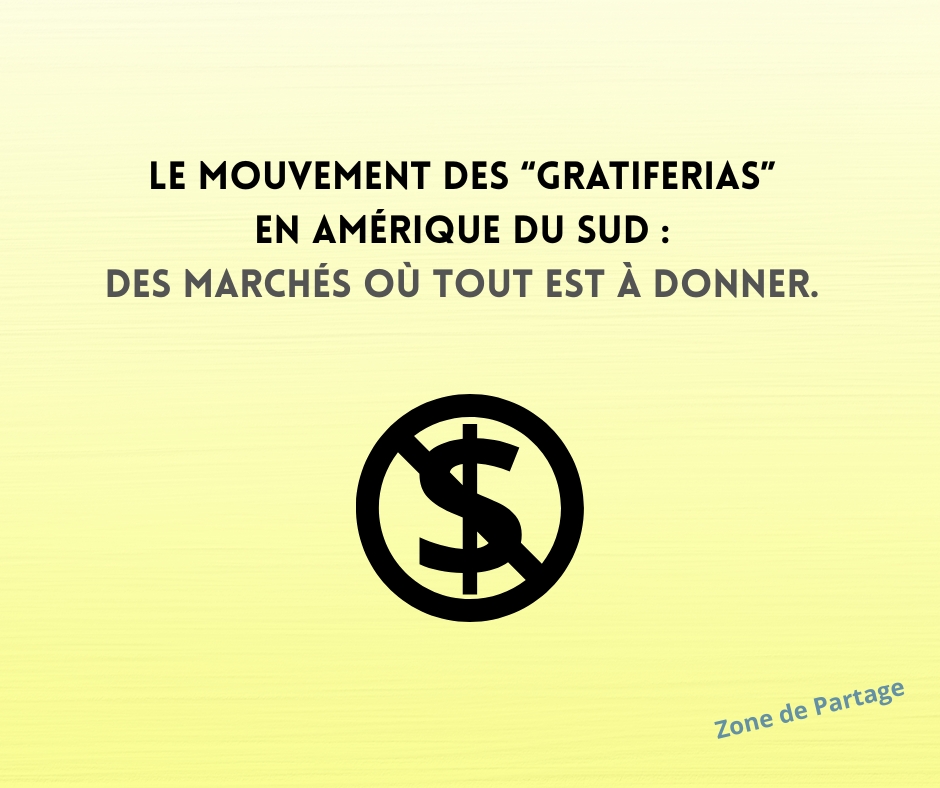
🛍️ Et si un marché fonctionnait sans argent, sans troc, et sans contrepartie ?
C’est le principe des Gratiferias, nées en Amérique du Sud au début des années 2010. Le mot vient de la contraction de gratis (gratuit) et feria (marché). Ces événements publics, ouverts à toutes et tous, reposent sur un principe radicalement simple : tout ce qui s’y trouve est à donner. Sans rien attendre en retour.
📍 Origines et fonctionnement
Le mouvement des Gratiferias est né en Argentine, dans un contexte de crise économique et de remise en question du modèle de consommation. Le concept a été popularisé par Ariel Rodríguez Bosio, un activiste argentin qui souhaitait expérimenter un espace d’échange non marchand dans l’espace public. (Première Gratiferia le 14 février 2010 à Buenos Aires).
Contrairement au troc ou aux “zones de gratuité conditionnelle” (espaces où la gratuité dépend d’une règle, d’un engagement ou d’un échange symbolique), une Gratiferia repose sur trois règles fondamentales :
- On peut venir sans rien apporter.
- On peut repartir avec ce que l’on veut.
- Il n’y a pas de contrôle marchand, ni de contrepartie.
Les objets peuvent être des vêtements, des livres, des jouets, des plantes, des outils… mais aussi des services, des gestes, ou des paroles.
🌎 Une diffusion internationale
Après l’Argentine, le mouvement s’est étendu à d’autres pays d’Amérique latine, notamment au Chili, en Uruguay, en Colombie et au Brésil, souvent porté par des collectifs citoyens, des groupes écologistes ou des initiatives solidaires.
Des Gratiferias ont aussi vu le jour en Espagne, en France, en Allemagne, au sein d’universités, de quartiers, ou lors de festivals. Le modèle s’adapte aux cultures locales, mais garde la même logique : proposer un espace sans transaction.
Au-delà de l’aspect pratique (réduire les déchets, désencombrer son logement), les organisateurs insistent sur l’impact social :
“Ce que tu donnes peut n’avoir plus de valeur pour toi, mais il peut avoir beaucoup de sens pour quelqu’un d’autre.”
🔎 Un geste simple, mais subversif
Dans un monde basé sur l’échange marchand, l’idée de donner sans retour peut sembler naïve, voire imprudente. Pourtant, les Gratiferias ont montré qu’il est possible de créer, même temporairement, des espaces basés sur la confiance, la coopération, et la désactivation de la logique de profit.
Certaines Gratiferias deviennent aussi des lieux de parole, d’écoute, d’ateliers partagés, ou d’éducation populaire. Le don y devient un moyen de recréer du lien social, de sortir du chacun pour soi, et de valoriser l’abondance autrement que par l’accumulation.
💬 Une idée à vivre, ici et maintenant
La Gratiferia n’est pas seulement un marché gratuit. C’est une manière de repenser la relation à l’objet, aux autres, et à soi-même.
Dans la vie quotidienne, cela peut nous inspirer :
– à donner ce que l’on n’utilise plus, même sans “bonne raison”,
– à créer un petit coin de gratuité dans son immeuble, sa cour, son école,
– à offrir un service ou un savoir sans attendre un retour,
– à croire que la générosité peut exister sans contrôle.
Donner librement, ce n’est pas perdre. C’est faire circuler ce qui est déjà là. Et parfois, ce que l’on donne sans attente revient autrement : sous forme de lien, de reconnaissance, ou de confiance retrouvée.
C’est peut-être cela, au fond, la force tranquille des Gratiferias : elles rappellent que la gratuité, bien pensée, peut être un moteur de la société.