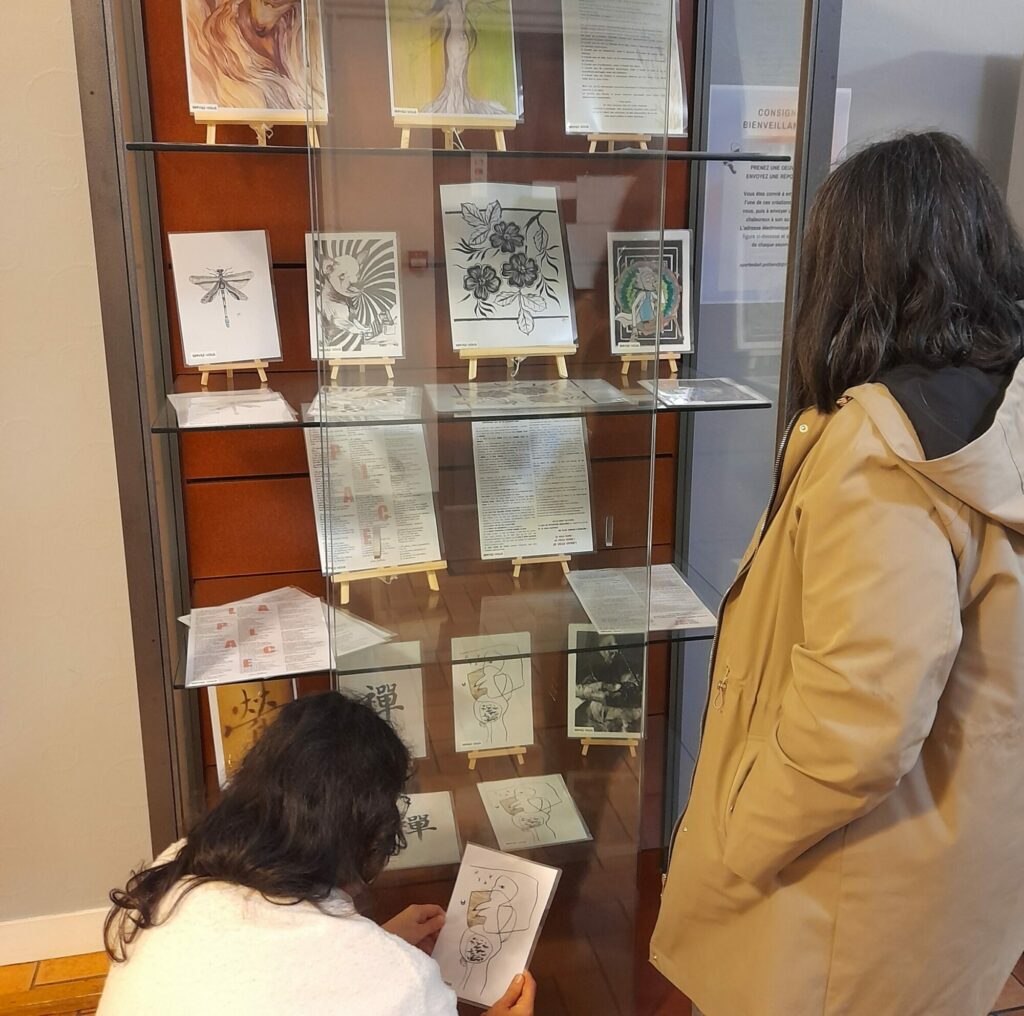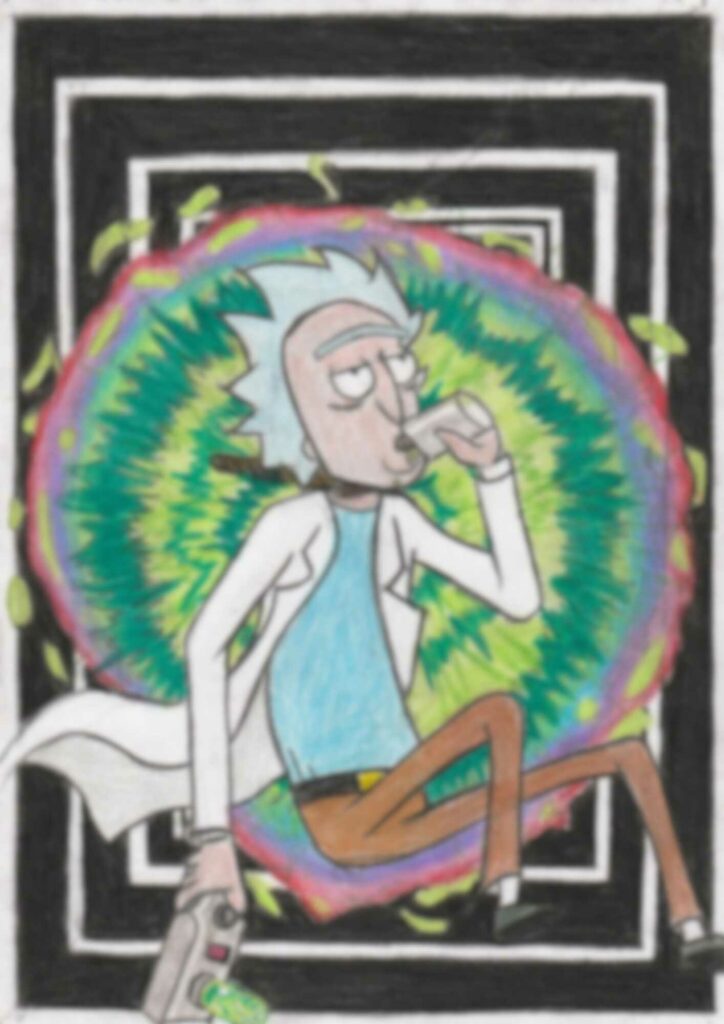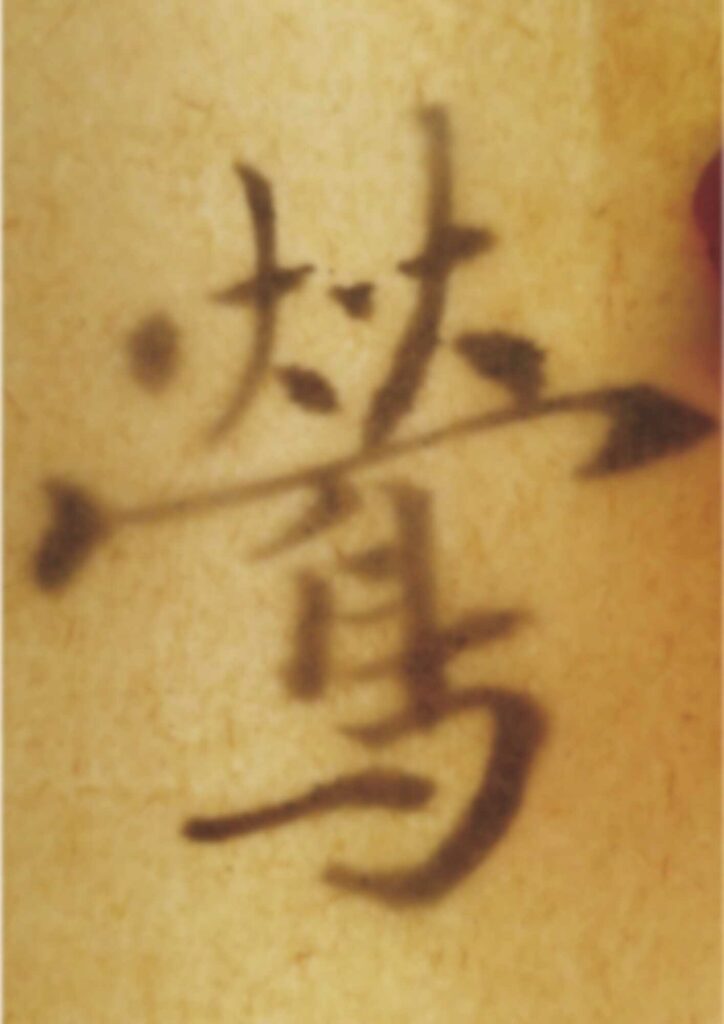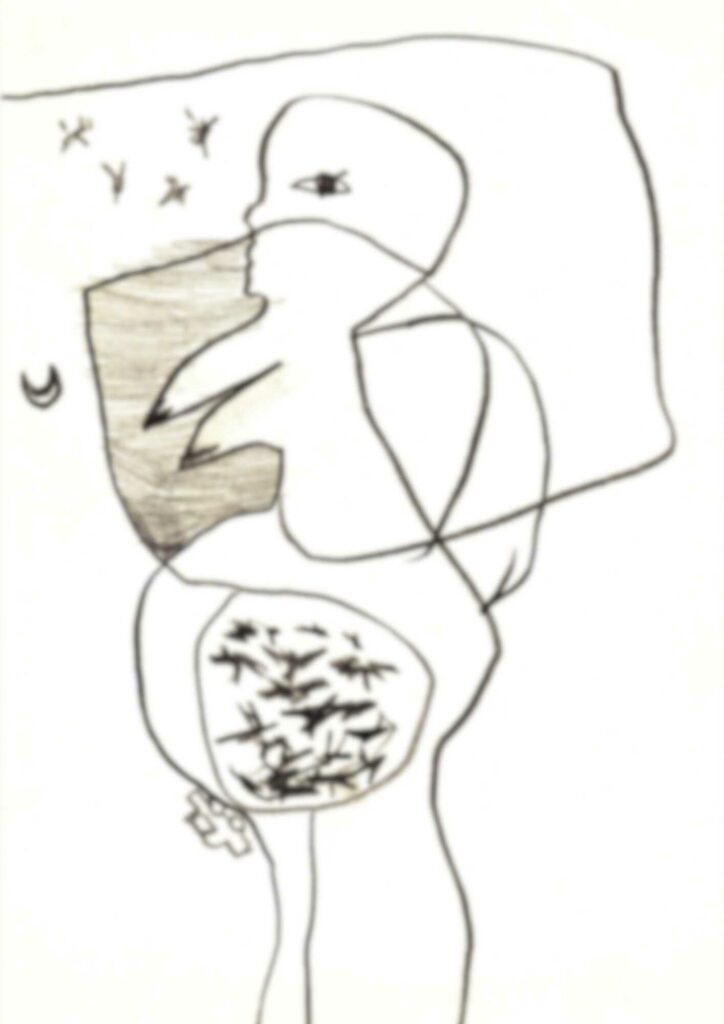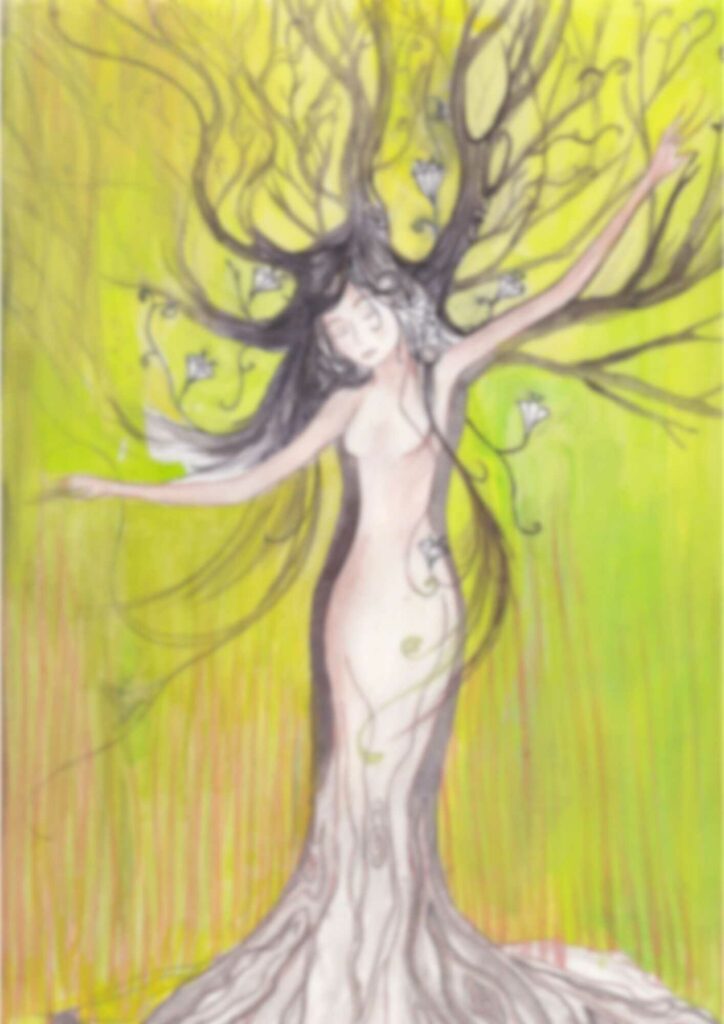Une Histoire de Partage (14) : l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert

📘 Et si, au XVIIIe siècle, diffuser le savoir avait été un acte politique ?
C’est ce qu’ont tenté Diderot et d’Alembert avec l’Encyclopédie, un projet inédit dans l’Europe des Lumières : mettre à la disposition du plus grand nombre les connaissances disponibles de leur temps, dans tous les domaines, sans distinction entre les savoirs “nobles” (sciences, philosophie) et les savoirs “pratiques” (métiers, techniques artisanales).
📚 Un projet monumental, pensé pour être utile à tous
L’Encyclopédie, dont le titre complet est Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, paraît entre 1751 et 1772, en 28 volumes. Elle rassemble plus de 70 000 articles, rédigés par environ 150 contributeurs, dont des figures comme Rousseau, Voltaire ou Turgot.
Contrairement aux ouvrages réservés aux savants ou aux clercs, l’Encyclopédie adopte un ton pédagogique et descriptif. Elle propose :
- des définitions claires,
- des schémas techniques détaillés,
- des descriptions d’outils et de gestes manuels,
- des raisonnements scientifiques fondés sur l’observation.
Elle valorise autant l’horloger que le mathématicien, autant le cultivateur que le philosophe.
⚙️ Une volonté explicite de démocratiser la connaissance
À une époque où l’accès à la lecture est encore limité et où l’enseignement reste réservé aux élites, le projet de l’Encyclopédie repose sur une idée simple et radicale :
le savoir ne doit pas être réservé à une minorité. Il appartient à tous.
Pour les encyclopédistes, la connaissance est un outil d’émancipation. Elle permet à chacun :
- de comprendre le monde,
- de questionner les autorités,
- et de participer à la transformation de la société.
Cela explique pourquoi le projet a été plusieurs fois censuré par le pouvoir royal et par l’Église. L’idée qu’un artisan puisse lire un article sur l’astronomie ou qu’un commerçant puisse accéder à une critique de l’intolérance religieuse inquiétait les autorités.
🌍 Un héritage encore visible aujourd’hui
L’Encyclopédie a marqué un tournant dans l’histoire de l’imprimerie, de la diffusion du savoir, et de la pensée critique. Elle a :
- nourri les débats pré-révolutionnaires,
- posé les bases du rationalisme moderne,
- influencé l’organisation des savoirs dans les systèmes éducatifs occidentaux,
- et ouvert la voie à d’autres entreprises éditoriales comme les dictionnaires grand public et, plus tard, les encyclopédies numériques.
Mais son objectif initial reste d’une grande actualité : rendre la connaissance libre, compréhensible, et partageable.
💬 Une morale pour aujourd’hui
Dans un monde saturé d’informations, mais où l’accès à une connaissance fiable reste inégal, l’Encyclopédie nous rappelle une chose fondamentale :
le savoir ne vaut que s’il circule.
Cela peut s’appliquer à chacun :
- partager ce qu’on sait avec clarté, sans jargon,
- expliquer au lieu de se moquer,
- publier des ressources utiles sans les enfermer derrière des barrières idéologiques,
- valoriser les savoir-faire, quels qu’ils soient, sans hiérarchie arbitraire.
Quand on prend le temps d’expliquer à quelqu’un ce qu’on sait, on prolonge l’esprit de l’Encyclopédie.
Et même à petite échelle, on contribue à une société plus juste et éclairée, parce que mieux informée.