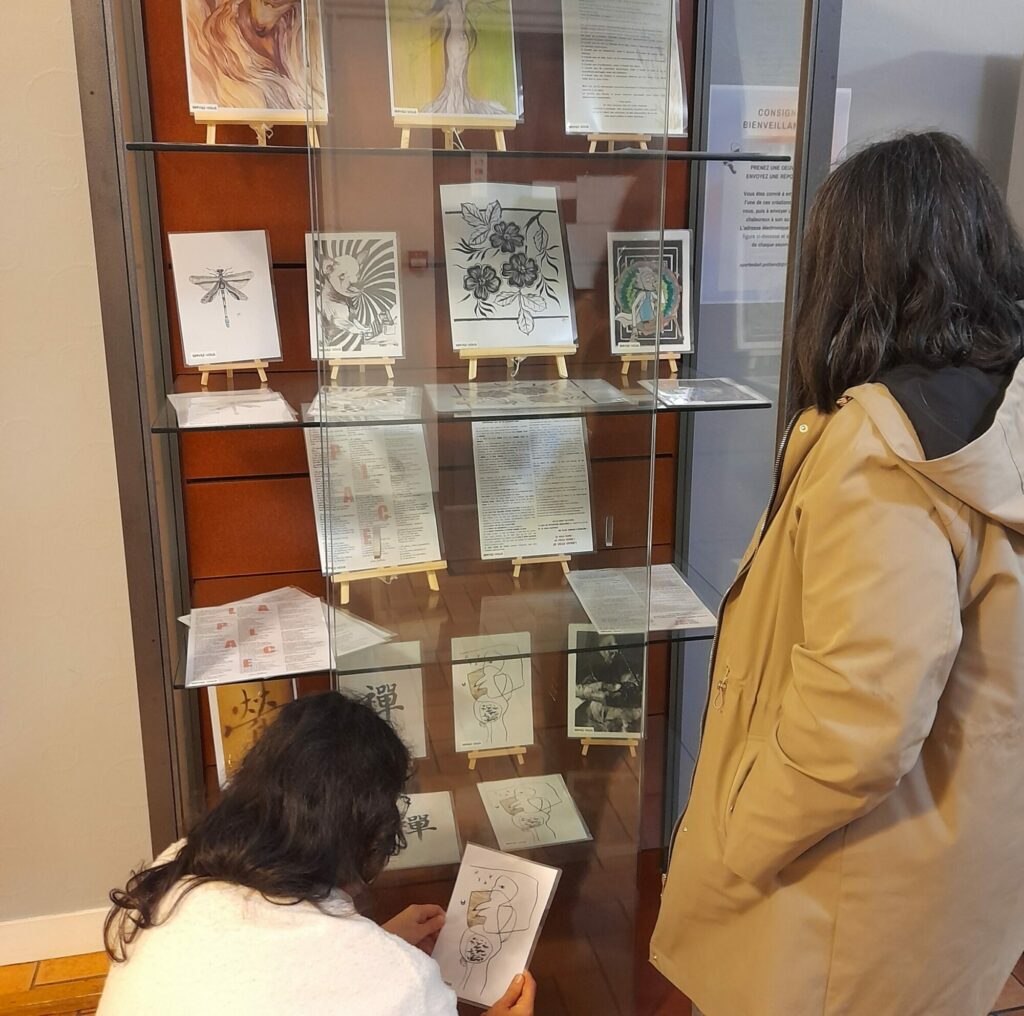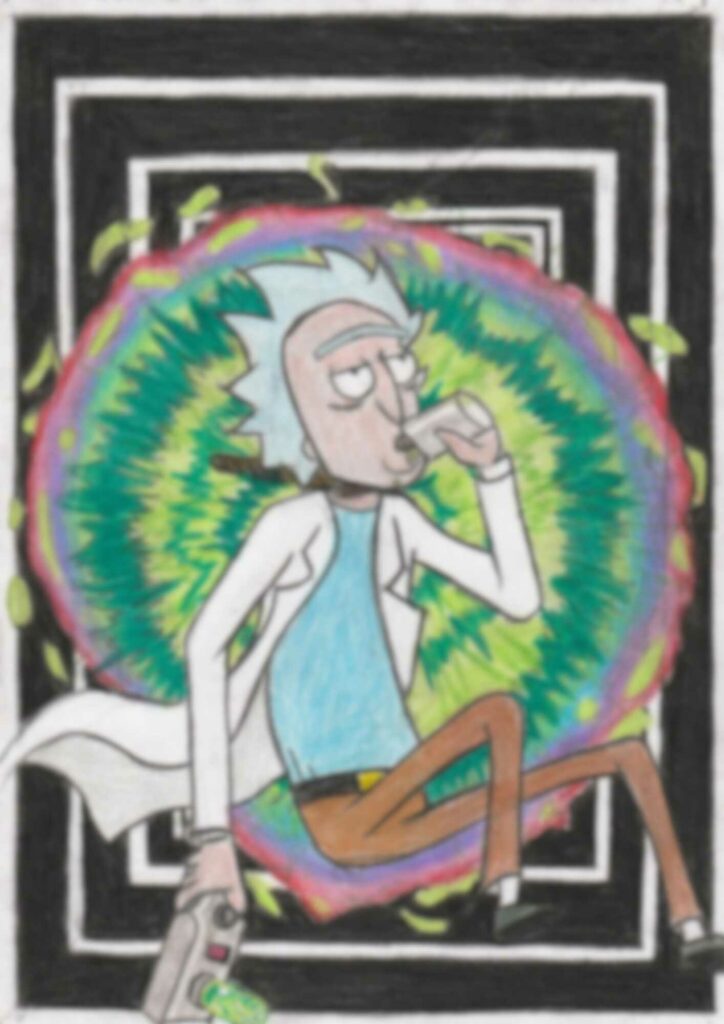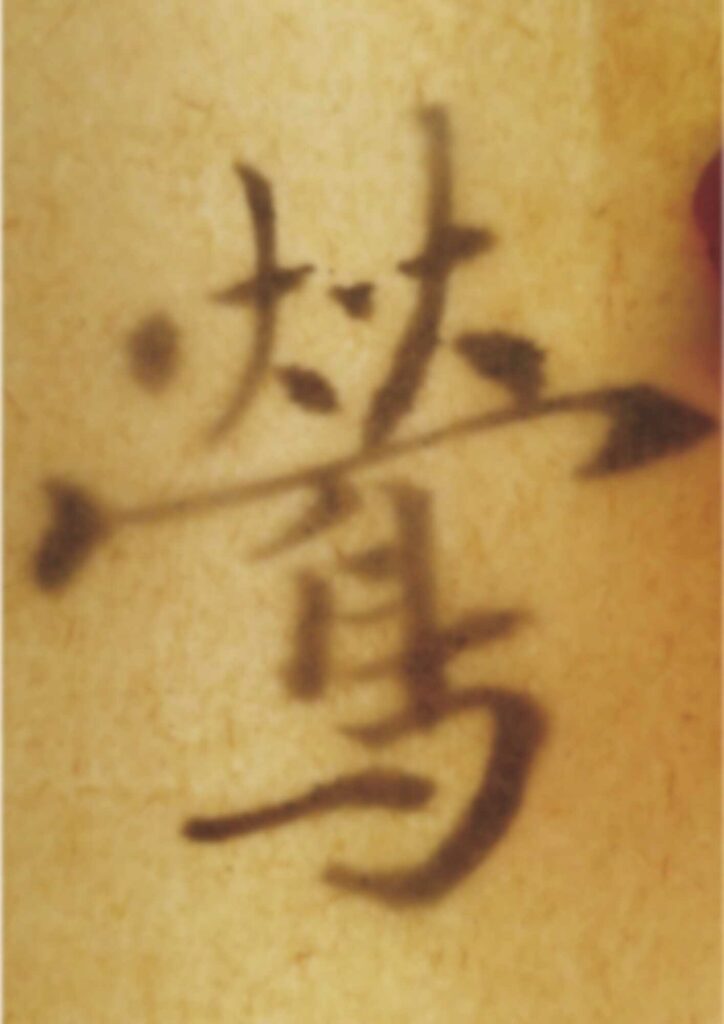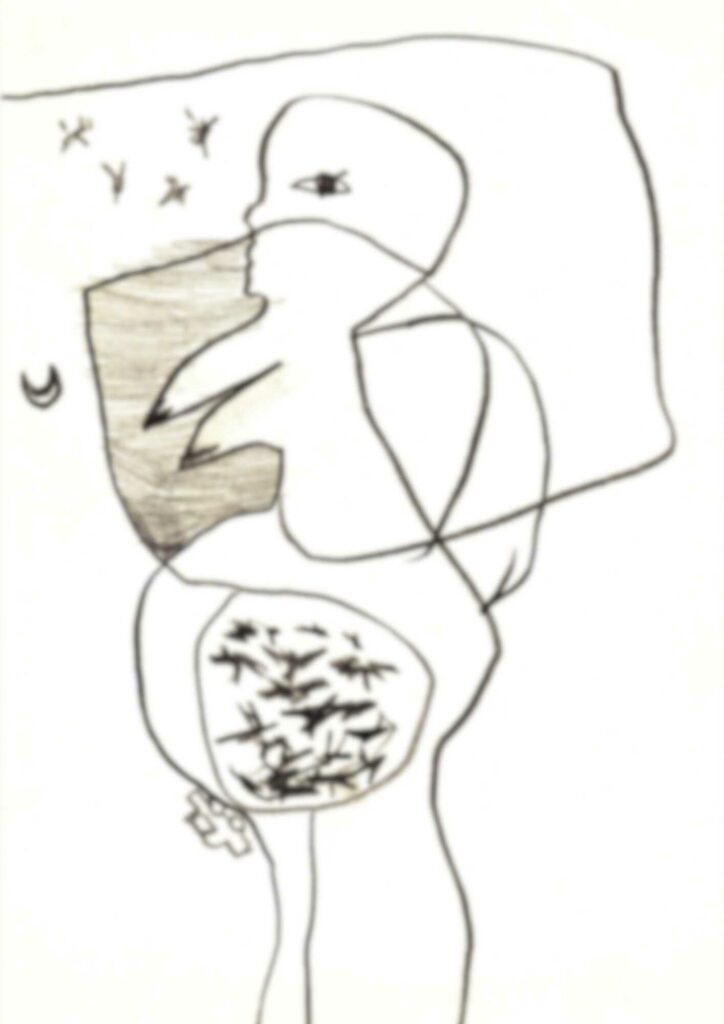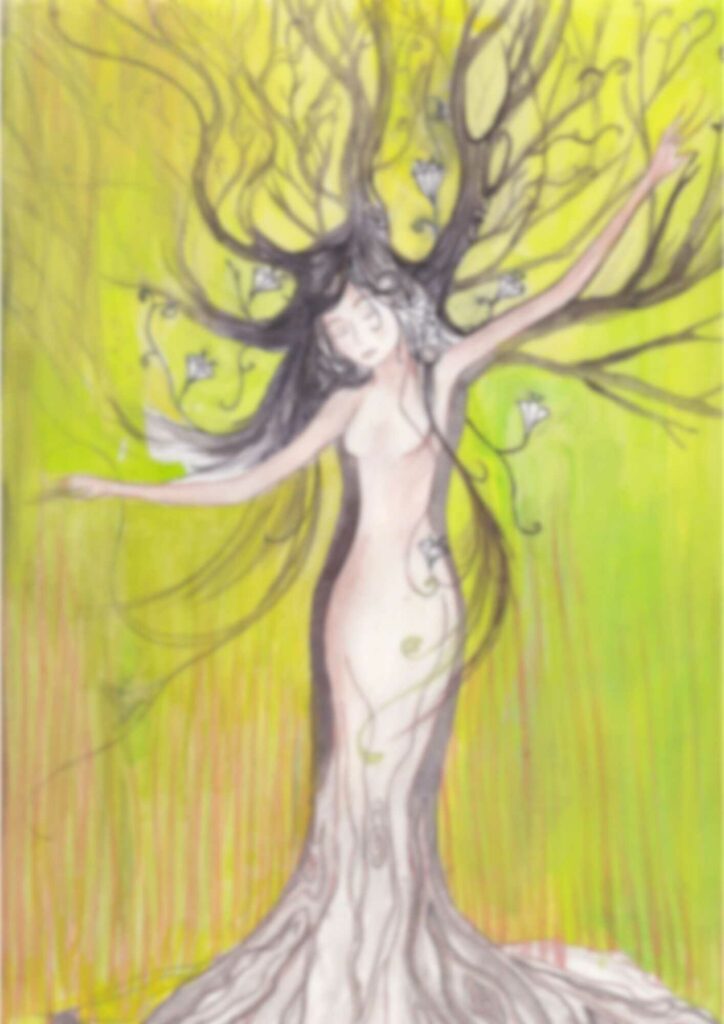Une Histoire de Partage (16) : les cuisines collectives zapatistes

🍲 Et si, au milieu d’une insurrection armée, l’une des premières choses à organiser était… une cuisine ouverte et solidaire ?
Depuis 1994, au Chiapas, dans le sud du Mexique, les communautés zapatistes ont construit un modèle de résistance singulier. Face à l’injustice, à la pauvreté et à l’abandon de l’État, elles ont levé des armes — mais surtout, elles ont bâti des écoles, des cliniques et des espaces de repas communautaires.
Pendant les heurts comme pendant les périodes de calme, on y cuisine pour les familles et les insurgés ; lors des rencontres et événements, pour les visiteurs. Parce que résister commence aussi par nourrir.
📜 Un contexte de lutte sociale, pas seulement militaire
Le 1er janvier 1994, jour de l’entrée en vigueur de l’ALENA (accord de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada), l’EZLN — Ejército Zapatista de Liberación Nacional — occupe plusieurs villes du Chiapas. Ce soulèvement est porté en grande partie par des populations indigènes qui dénoncent des siècles de marginalisation et de violences économiques.
Très vite, au-delà de la confrontation militaire, le mouvement prend une tournure communautaire et constructive. Les zapatistes ne cherchent pas seulement à combattre un système : ils veulent en construire un autre, fondé sur l’autonomie, l’autogestion et la solidarité.
🍽️ Des cuisines comme structures de survie et d’organisation
À partir de 1994, les travaux collectifs — dont des cuisines/comedores et des espaces de repas — se consolident dans l’autonomie. Leur fonction est double :
– répondre à un besoin vital : nourrir les habitants et les insurgés dans un contexte souvent en rupture avec les circuits marchands classiques ;
– structurer l’organisation sociale : répartir les tâches, valoriser les savoirs culinaires locaux et renforcer l’égalité entre femmes et hommes.
Les repas sont préparés avec ce que les gens peuvent donner ou produire : maïs, haricots, légumes, pain, parfois viande. Chacun contribue selon ses moyens, et tout le monde mange. Selon les lieux et les moments, ces comedores servent gratuitement ou à contribution libre ; l’accès des visiteurs peut aussi varier en période d’alerte.
Ces cuisines ont également une portée politique : elles incarnent, au quotidien, l’idée d’un monde où la nourriture est un droit collectif, pas une simple marchandise.
🌍 Un impact au-delà des zones zapatistes
Avec le temps, l’expérience d’autonomie zapatiste a inspiré d’autres mouvements sociaux en Amérique latine et ailleurs. Les pratiques d’auto-organisation (écoles, santé, gouvernance locale — et parfois cantines) dialoguent avec une histoire plus vaste des comedores populares dans la région. Elles montrent qu’on peut bâtir des solidarités concrètes, y compris en dehors des institutions classiques.
Aujourd’hui, même hors période de conflit, ces espaces existent dans de nombreuses communautés comme lieux de vie, d’accueil et de transmission. Leur ouverture aux visiteurs peut toutefois évoluer selon le contexte et les orientations du mouvement, notamment depuis les réorganisations internes récentes.
💬 Une morale à vivre ici et maintenant
Ce que les zapatistes nous rappellent, c’est qu’il ne s’agit pas seulement de nourrir une lutte. C’est dans la manière dont on nourrit les gens que la société que l’on veut bâtir se révèle.
Dans notre quotidien, cela peut vouloir dire :
– cuisiner pour plusieurs, même quand on est peu ;
– ouvrir sa table à des inconnus sans chercher de contrepartie ;
– créer des espaces (cantines solidaires, repas partagés, distributions gratuites) où chacun peut manger sans honte ni justification.
Partager la nourriture, ce n’est pas faire l’aumône. C’est poser un cadre où la dignité est préservée, même dans les moments difficiles.
Et c’est peut-être là l’un des gestes les plus puissants pour résister au monde de l’exclusion.