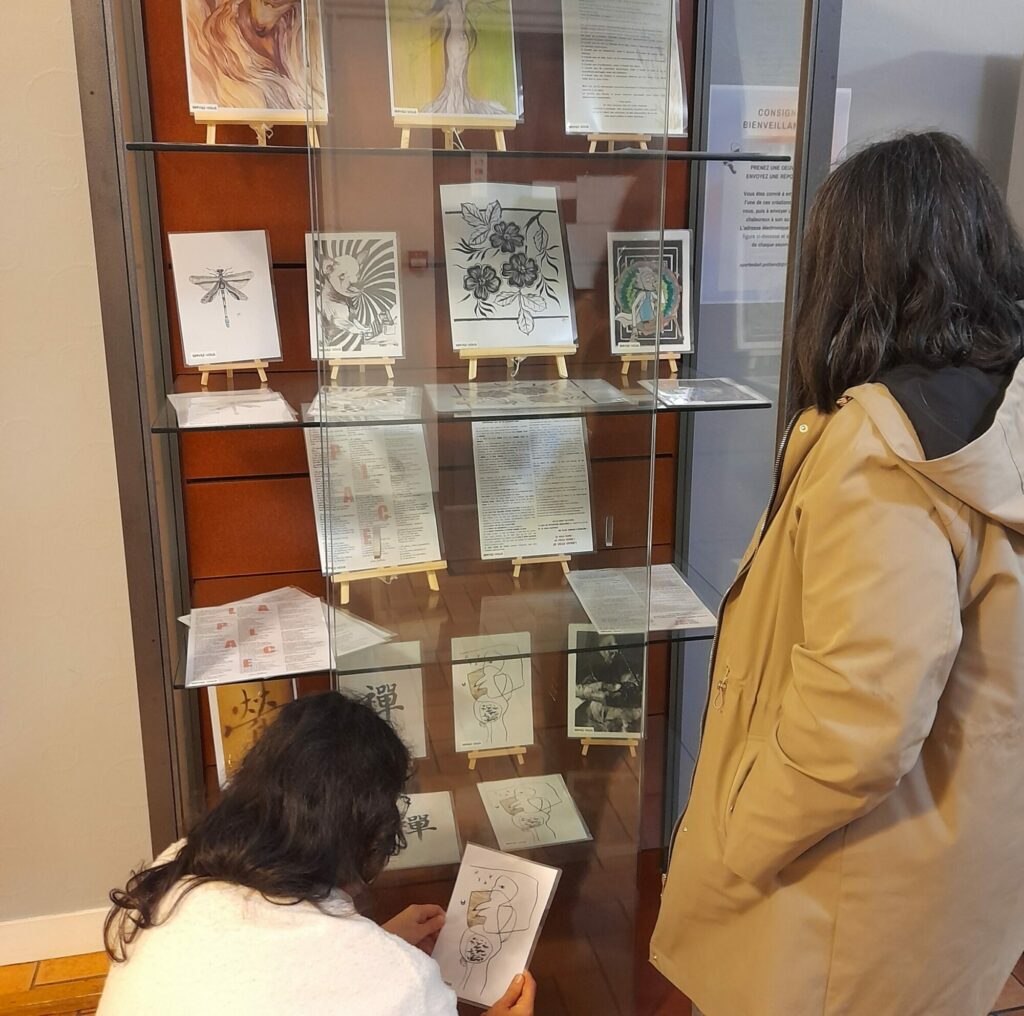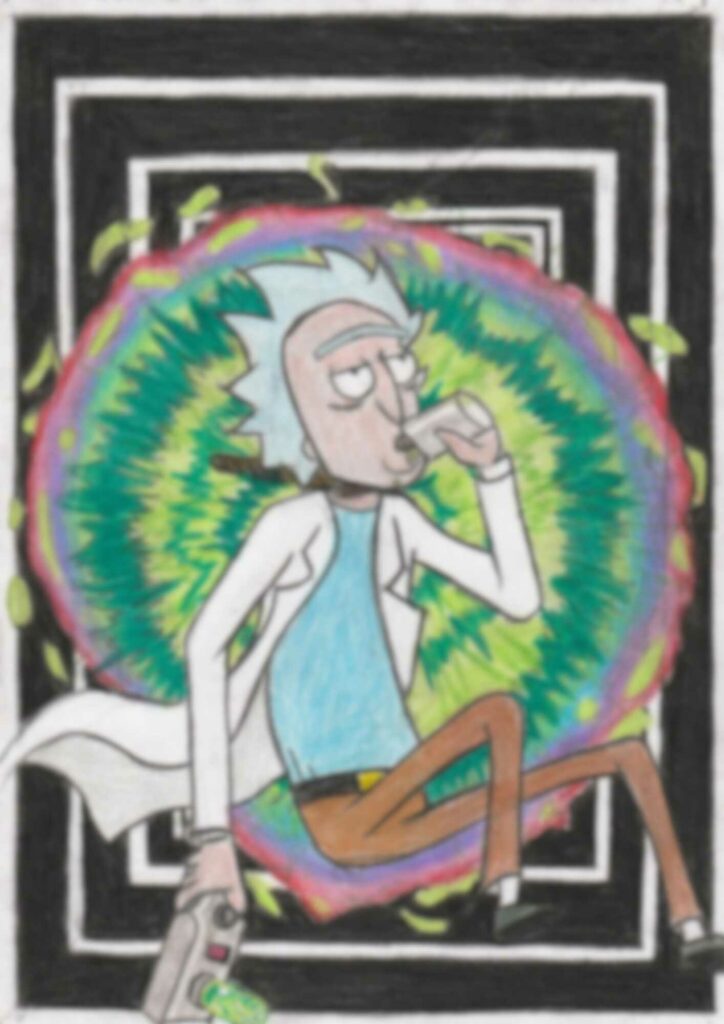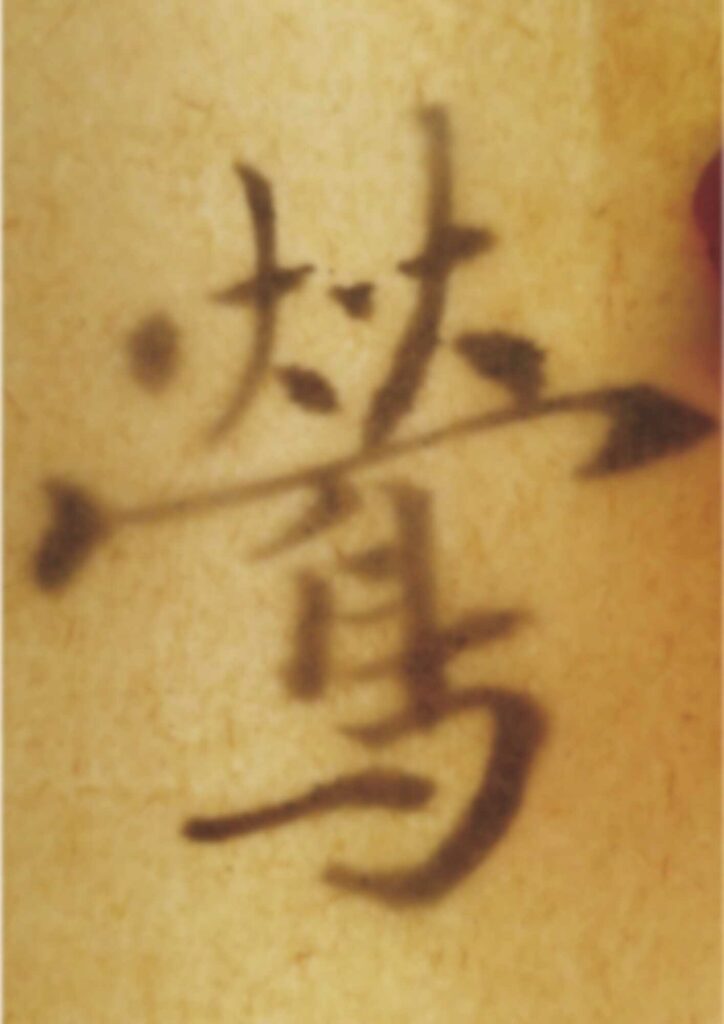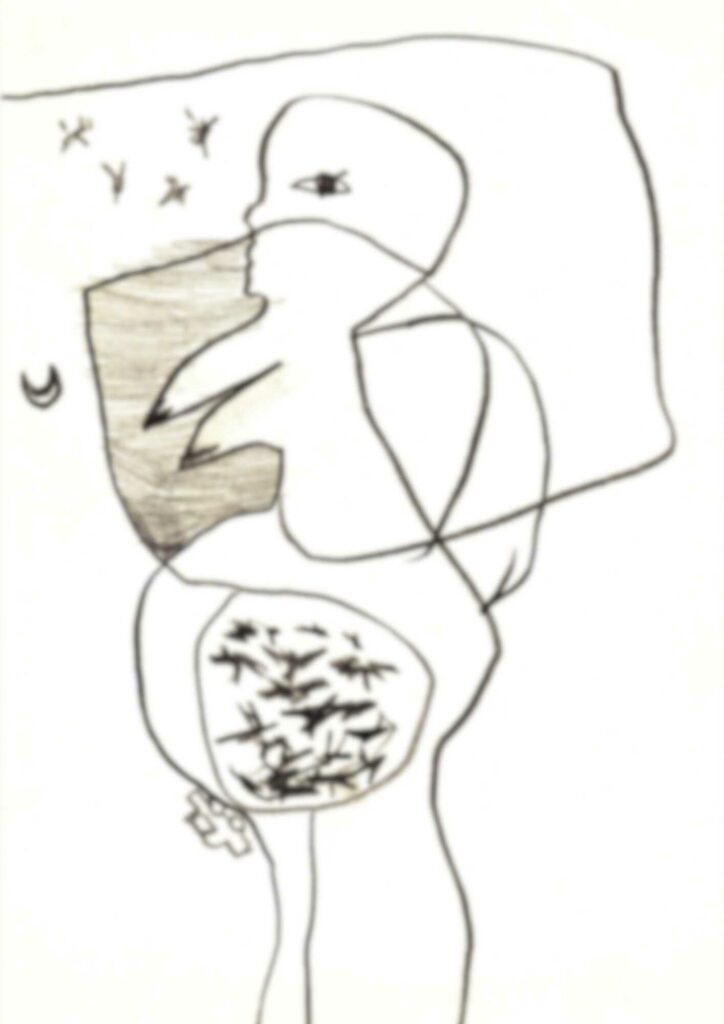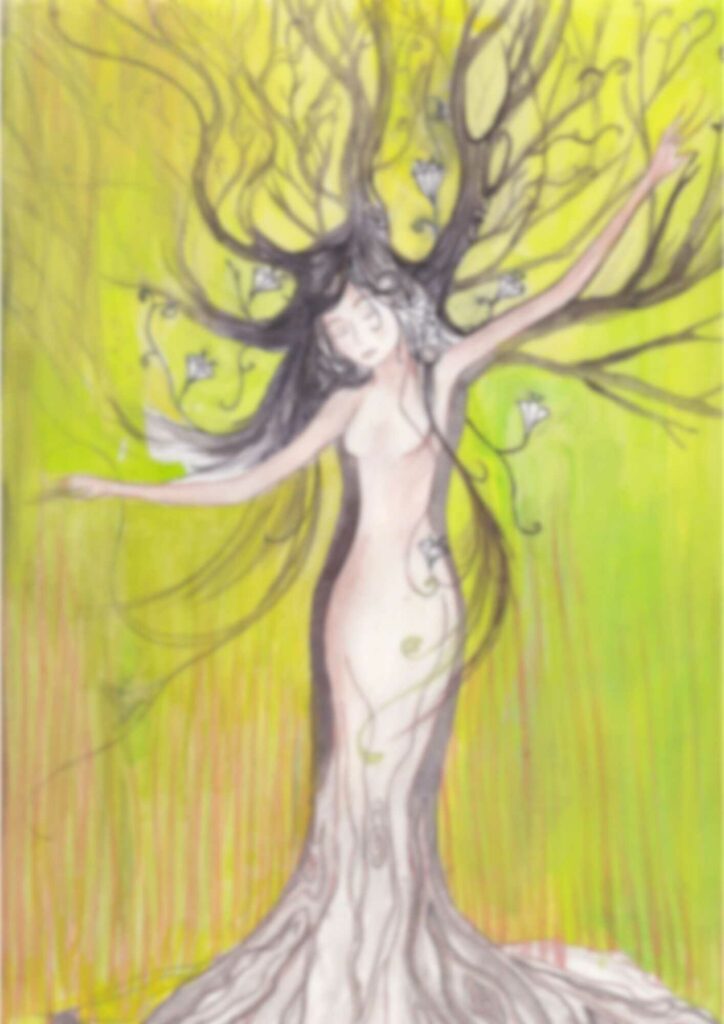Une Histoire de Partage (3) : l’enseignement gratuit de Socrate
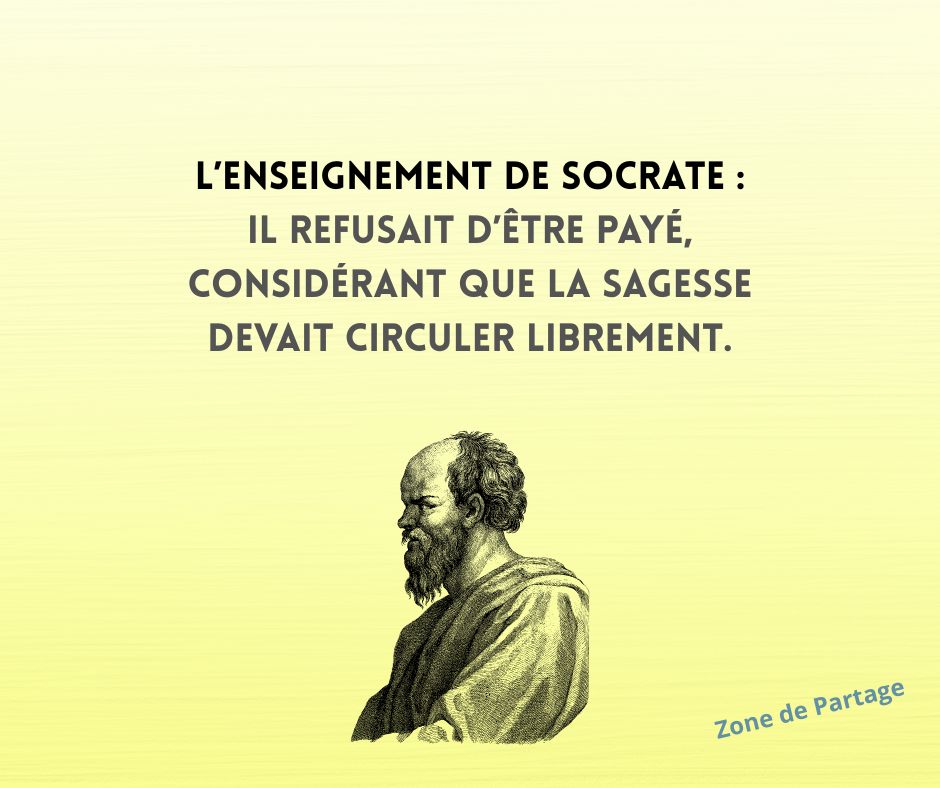
👣 Et si le vrai savoir ne s’achetait pas ?
Dans l’Athènes du Ve siècle avant notre ère, un homme se promenait sur les places publiques, interrogeait les passants, contredisait les savants, et refusait d’être payé pour cela. Cet homme, c’était Socrate.
Contrairement aux sophistes de son époque — des enseignants itinérants qui donnaient des cours payants d’éloquence ou de rhétorique —, Socrate ne vendait rien. Il affirmait que la philosophie, c’est-à-dire la recherche de la vérité et de la sagesse, ne devait pas être une marchandise.
🧠 Un choix volontaire et cohérent
Socrate n’était pas un marginal par défaut. Il aurait pu, comme d’autres, donner des leçons contre rémunération. Mais il choisit délibérément de ne rien faire payer. Pour lui, faire payer pour enseigner, c’était risquer de corrompre le sens même de la recherche philosophique.
Il ne se présentait pas comme un maître, mais comme un homme en quête de vérité, dialoguant avec d’autres. Sa méthode, connue sous le nom de maïeutique, consistait à poser des questions, souvent simples, pour aider son interlocuteur à examiner ses propres idées.
Ce refus de rémunération lui permettait de préserver son indépendance intellectuelle. Il ne dépendait d’aucun élève, d’aucun client, d’aucune école. Il enseignait sur la voie publique, gratuitement, à tous ceux qui voulaient discuter, quel que soit leur statut social.
🏛️ Une rupture avec les pratiques de son époque
À son époque, les sophistes étaient très présents dans la vie athénienne. Ils enseignaient aux jeunes hommes comment bien parler, convaincre, gagner des procès, faire carrière en politique. Leur savoir était technique et utile, mais souvent détaché d’un vrai souci de vérité.
Socrate, lui, pensait que la sagesse ne se transmet pas comme un savoir technique. Elle suppose du temps, du doute, du dialogue. Elle engage la personne tout entière.
Ce positionnement critique l’a rendu suspect aux yeux de certains. Il a été accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas honorer les dieux de la cité. Condamné à mort en 399 av. J.-C., il a refusé de fuir et a accepté de boire la ciguë, fidèle à ses principes jusqu’au bout.
📚 Une influence durable
Socrate n’a jamais écrit. C’est par les écrits de ses disciples, en particulier Platon et Xénophon, que son enseignement a traversé les siècles. Mais son attitude — enseigner sans contrepartie financière, encourager chacun à penser par lui-même, poser des questions plutôt que donner des réponses — a profondément influencé la philosophie occidentale.
Son modèle a été repris et adapté par des écoles comme le stoïcisme, le cynisme ou même le christianisme primitif, qui valorisaient la simplicité, la transmission orale, et le détachement des biens matériels.
Encore aujourd’hui, Socrate incarne une idée exigeante : la pensée libre ne doit pas dépendre de l’argent. Ce n’est pas qu’elle ne mérite pas salaire ; c’est qu’elle s’abîme quand elle devient un produit.
💬 Une idée à retenir pour notre vie quotidienne
Aujourd’hui, beaucoup de savoirs sont monétisés : cours privés, vidéos payantes, coaching, formations en ligne. Il n’y a rien de mal à cela. Mais le message de Socrate reste d’actualité : tout ne doit pas avoir un prix. Certaines choses doivent pouvoir circuler librement, par respect pour leur valeur humaine et collective.
Dans la vie de tous les jours, cela peut signifier :
- prendre le temps d’expliquer quelque chose sans attendre de retour,
- partager une compétence sans chercher de bénéfice immédiat,
- transmettre un savoir à quelqu’un qui n’a pas les moyens de le payer,
- considérer que la valeur d’une discussion vient d’abord de sa sincérité, pas de son coût.
Et c’est peut-être cela que Socrate avait compris : plus on garde la sagesse pour soi, plus elle s’éloigne de ce qu’elle devrait être.