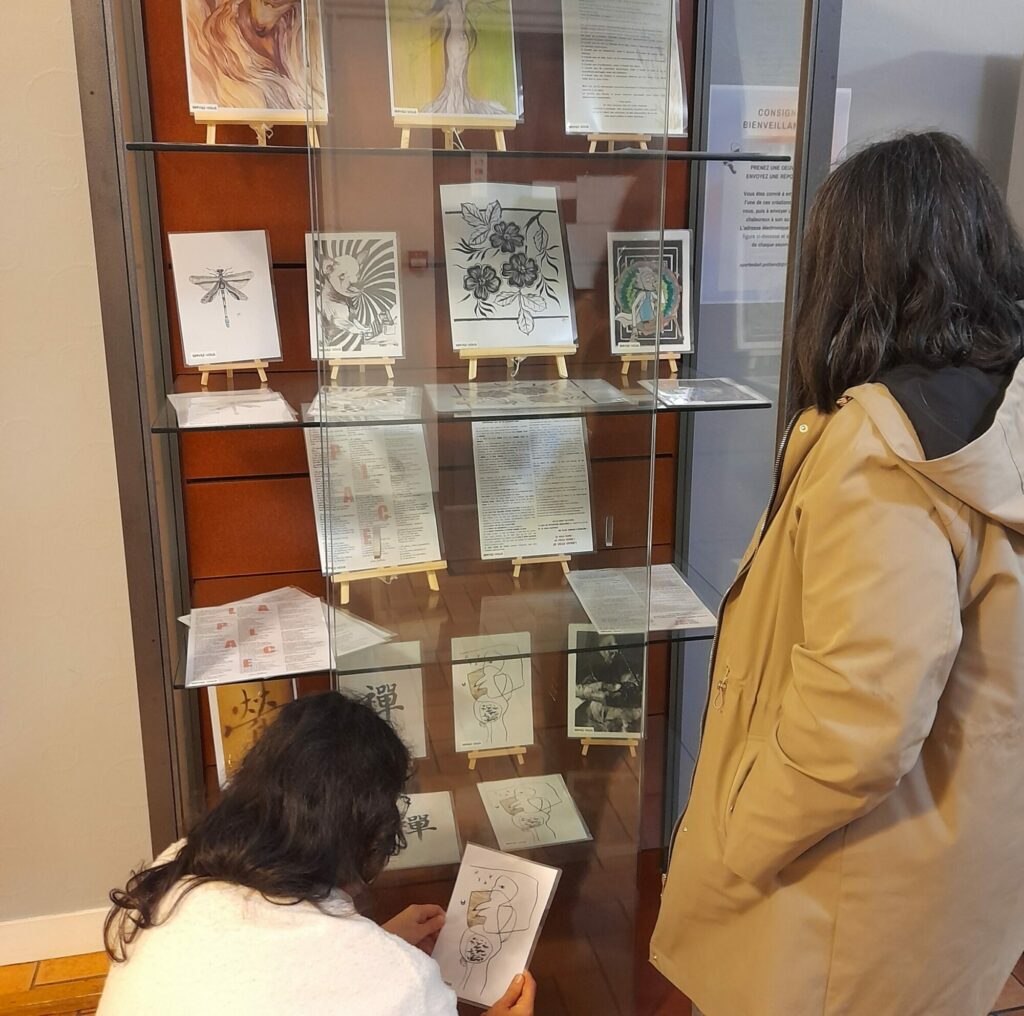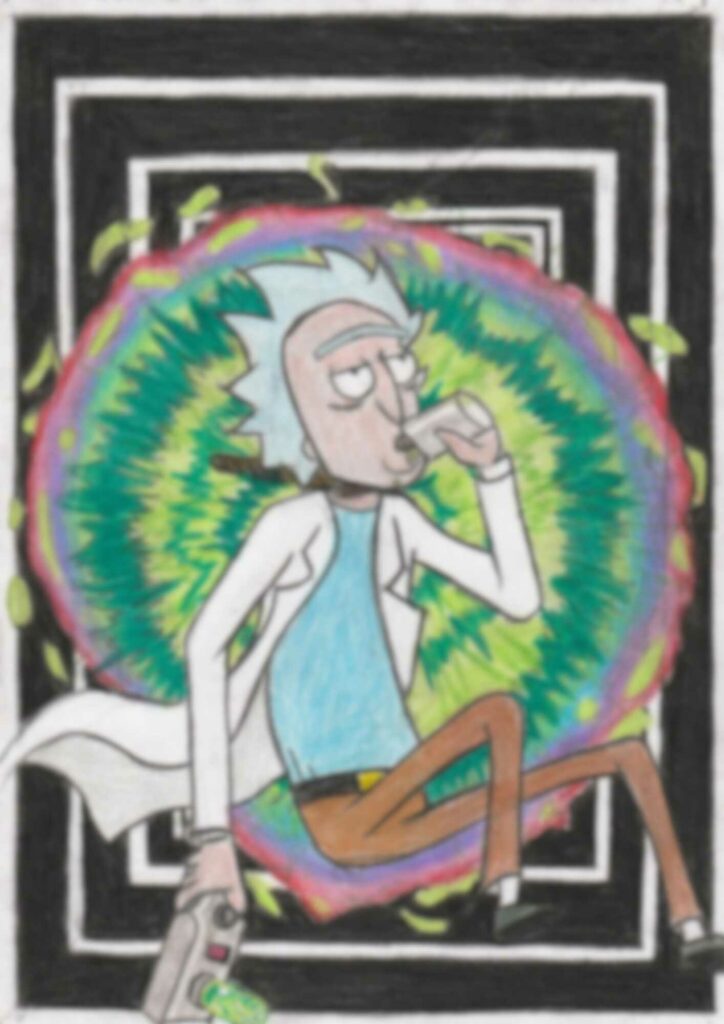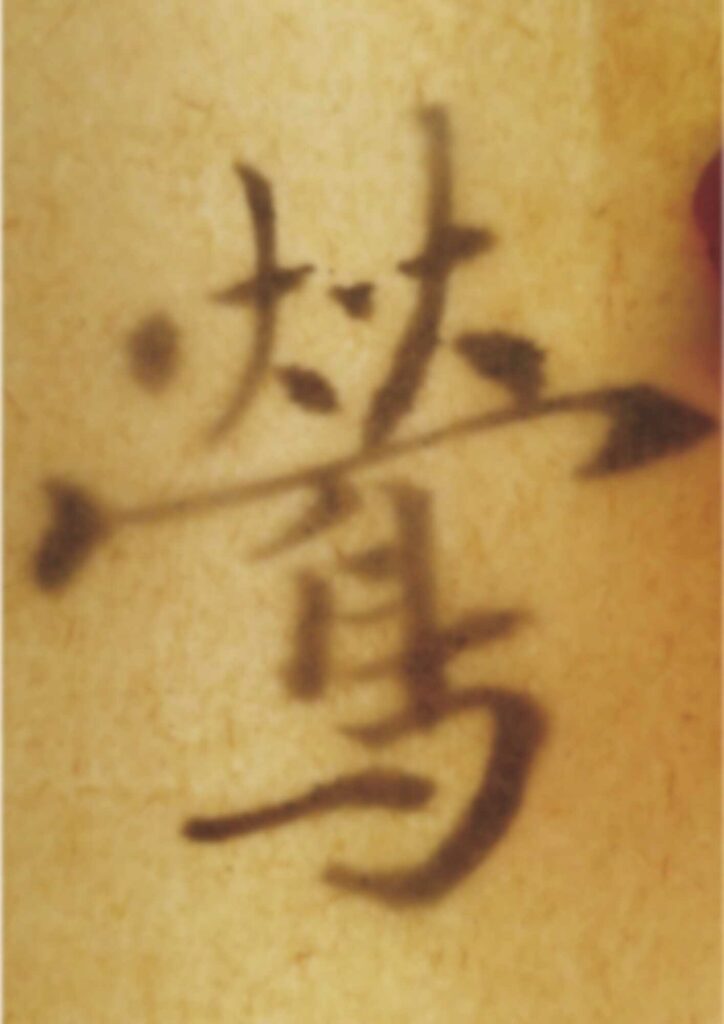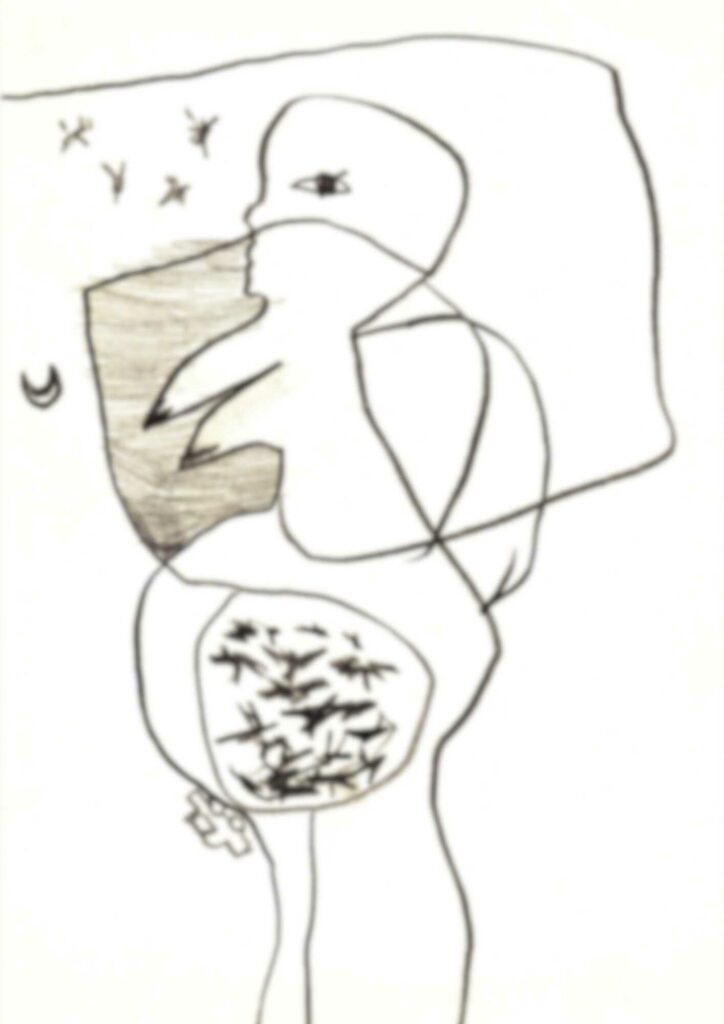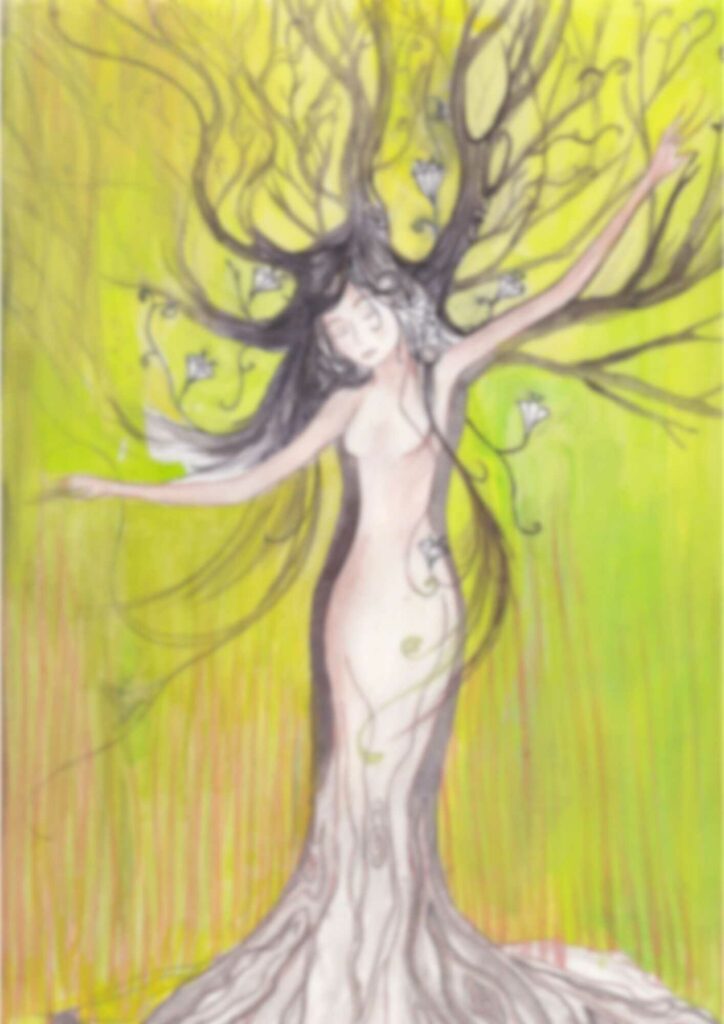Une Histoire de Partage (6) : les dîners gratuits des soufis

🍲 Et si offrir un repas à tous avait été, pendant des siècles, un acte spirituel ?
Dans de nombreuses régions du monde musulman, du Maghreb à l’Asie centrale, une tradition ancienne a traversé les siècles : les repas gratuits organisés par les confréries soufies. Ces dîners, appelés parfois table ouverte, repas de dhikr ou souper du jeudi soir (veille du vendredi saint), n’étaient pas réservés aux croyants ni aux initiés. Ils étaient ouverts à tous, riches ou pauvres, passants ou fidèles.
🕌 Une tradition spirituelle, mais aussi sociale
Les confréries soufies sont des groupes religieux organisés autour d’un maître spirituel, souvent appelés tariqas. Elles sont apparues dès le VIIIe siècle dans le monde musulman et ont joué un rôle important dans la diffusion de l’islam, mais aussi dans la vie quotidienne.
Parmi leurs activités régulières figuraient :
- des rencontres spirituelles (chants, prières, méditation),
- des enseignements religieux et éthiques,
- et surtout, l’organisation de repas gratuits.
Ces repas étaient souvent servis dans les zawiyas (lieux d’accueil et de prière), les tekke (loges soufies dans l’Empire ottoman) ou les maisons des membres. Ils suivaient parfois des rituels simples : bénédiction, silence, prière collective, partage.
🍞 Nourrir le corps et apaiser le cœur
Ces dîners avaient plusieurs fonctions :
- accueillir sans distinction : nul besoin d’être membre, croyant ou pratiquant pour s’y asseoir.
- réduire les inégalités : chacun recevait la même chose, dans la même assiette.
- favoriser la parole libre : autour du repas, on échangeait, on racontait, on écoutait.
- cultiver l’humilité : les maîtres eux-mêmes servaient parfois à table, aux côtés des plus pauvres.
Ce geste était ancré dans une vision spirituelle claire : la nourriture partagée est une forme d’amour en acte, un moyen de se rapprocher de Dieu par le service désintéressé d’autrui. Offrir à manger était une prière vivante.
🌍 Une pratique qui a traversé les époques
Dans certaines régions, ces repas soufis sont encore organisés aujourd’hui, sous des formes parfois modernisées : soupes populaires pendant le Ramadan, repas communautaires hebdomadaires, ou cuisines collectives ouvertes aux plus démunis.
Au-delà du cadre religieux, cette tradition a influencé des formes d’hospitalité durable : dans les souks, les oasis, les caravansérails (bâtiments destinés à accueillir les caravanes de marchands et de voyageurs), on retrouve cette idée que nourrir un inconnu est une responsabilité morale, et non un acte d’exception.
Des anthropologues soulignent que dans plusieurs régions, ces repas ont contribué à la paix locale en temps de crise, en offrant un lieu de parole, de rencontre, et de solidarité réelle entre habitants.
💬 Une morale simple et toujours actuelle
Aujourd’hui, dans un monde où tout s’achète, où le lien social se fragilise, et où beaucoup vivent isolés, l’idée d’un repas gratuit, partagé, ouvert, reste valable. Elle nous rappelle qu’on peut créer du lien sans discours, sans argent, simplement en cuisinant ensemble, en servant, en mangeant côte à côte.
Dans la vie quotidienne, cela peut prendre des formes très simples :
- inviter quelqu’un à dîner sans raison spéciale,
- apporter un repas à une personne malade ou isolée,
- organiser un pique-nique ouvert, où chacun peut venir sans inscription,
- participer à une cantine solidaire.
Nourrir quelqu’un, ce n’est pas seulement répondre à un besoin physique.
C’est reconnaître sa présence. C’est dire : tu as ta place ici.
Et dans un monde où beaucoup se sentent invisibles, ce petit geste peut redonner de la dignité et de la confiance, en soi et en l’autre.